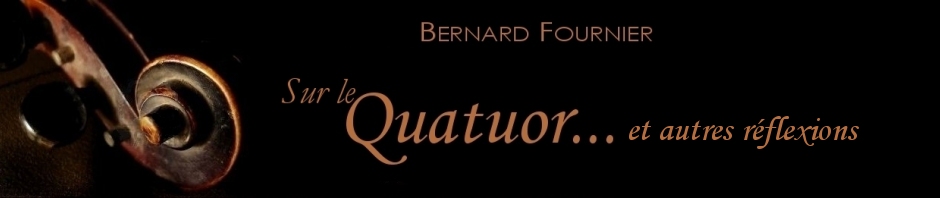Les derniers quatuors de Beethoven, les Opus 127, 132, 130, 131, 135 – selon l’ordre chronologique de leur composition – font partie des plus hauts chefs-d’œuvre de la musique et pourraient être classés en tant que tels en bonne place dans je ne sais quel catalogue du patrimoine mondial de l’humanité.
Ils sont longuement commentés dans mon Histoire du Quatuor à cordes (tome I, pages 605 à 961, Fayard, 2000) mais ils autorisent et attendent d’autres gloses qui pourraient permettre aux interprètes d’en révéler de nouveaux aspects tant ils sont riches de sens et de beautés multiples à découvrir.
J’ai envie aujourd’hui d’écrire quelques lignes différentes de celles de mon livre sur le sublime adagio à variations de ce quatuor. Je vais également dire quelques mots de l’esthétique générale de ce quatuor et de ses trois autres mouvements. Pour que mes propos ne restent pas abstraits, je donne quelques exemples en me référant pour les minutages à la magnifique version du Quartetto Italiano que je ne saurais trop recommander.
Beethoven, Douzième Quatuor opus 127 en mi bémol majeur
Composé de juin 1824 à janvier 1825. Première exécution par le Quatuor Schuppanzigh à Vienne le 6 mars 1825.
I – Maestoso – Allegro teneramente (forme sonate). II – Adagio ma non troppo e molto cantabile (thème et 6 variations + coda). III – Scherzando vivace (forme scherzo avec coda). IV – Allegro (forme sonate).
Le Douzième Quatuor, page apollinienne, témoigne d’un bout à l’autre d’une inspiration lumineuse et luxuriante reflétant quelque chose de la joie intérieure qui habitait Beethoven dans les mois où il composa cette œuvre apaisée, dans un état de fusion intime avec la nature. Sorte d’« Ange au sourire » de la création beethovénienne, ce quatuor explore avec une maîtrise souveraine les possibilités d’un nouveau lyrisme instrumental à la fois élargi dans son geste, approfondi et intériorisé dans sa visée, intensifié dans son expression.
Cela se traduit notamment par un mélodisme plus ample (utilisation de grands intervalles expressifs) et plus vocal, porté par des textures subtilement enchevêtrées ou un contrepoint foisonnant avec l’émancipation de figures qui renouvellent entièrement le principe de l’ornementation ; ainsi le trille, abondamment sollicité dans cette œuvre sous les formes les plus diverses, recentre-t-il la note sur elle-même, sur sa propre vibration, creusant profondément en elle pour en exprimer comme une palpitation de l’âme.
Le sentiment de plénitude effusive et de rayonnement heureux qui prévaut dans l’Opus 127 n’exclut cependant pas quelques zones d’ombre : le second thème (mes. 41 [1’12]) en sol mineur de l’Allegro teneramente, certes lyrique comme le premier, se révèle d’une troublante mélancolie et, plus loin, la brève deuxième séquence du développement (mes. 121-133 [3’14-3’30]) libère la seule explosion de violence de ce quatuor ; au cœur de l’Adagio ma non troppo (troisième variation, Adagio molto espressivo en mi majeur, mes. 59 [7’06]), perce l’inquiétude métaphysique, elle-même au centre de la pensée beethovénienne ; le trio (mes. 144 [4’41]) du très ludique Scherzando vivace est un Presto qui fait alterner couleurs sombres et claires, fièvre et jubilation. Ces quelques passages ne font que renforcer par contraste l’image dominante d’une œuvre où s’exprime le sentiment d’accomplissement d’un moi en paix avec lui-même. Le discours essentiellement fluide et continu ménage le plus souvent des transitions souples et s’appuie dans chacun des quatre mouvements sur un matériau sans tension interne privilégiant l’intervalle de quarte.
L’originalité de ce quatuor tient moins à son architecture d’ensemble qu’à la forme de chacun de ses quatre mouvements, à leur langage et leur esthétique. Outre la remarquable unité expressive et structurale (affinités thématiques, même type de construction avec notamment pour chacun d’eux une introduction et une coda d’une grande importance), ce qui est nouveau, c’est la nature de l’itinéraire expressif de l’œuvre avec l’importance sans précédent accordée à la sphère du mouvement lent ; sa durée est équivalente à celle des trois autres et porte l’essentiel du poids spirituel du quatuor.
Le premier mouvement s’ouvre avec une séquence Maestoso, page d’une rare somptuosité sonore qui se dresse comme un portique majestueux au seuil de cette œuvre, mais aussi de l’ensemble des cinq derniers quatuors, marquant symboliquement le passage vers un univers musical hautement spiritualisé. Geste lui-même éminemment transcendantal que celui de la ligne ascendante des accords de ce Maestoso, et plus encore celui de sa réinterprétation à deux reprises toujours plus haut dans l’espace (successivement à partir de mi bémol, puis sol, mes. 75 [1’58], puis do, mes. 135 [3’31]) et de son ellipse – un silence (mes. 239 [5’53]) se substitue au quatrième énoncé préparé et attendu – avant une coda transcendantale reposant sur une répétition quasi litanique d’éléments du premier thème par les voix médianes tandis que le violon fait planer une mélodie extatique dans l’aigu. Constituant l’introduction du mouvement, la séquence Maestoso évolue ensuite librement par rapport aux articulations de la forme sonate : elle réapparaît à la fin de l’exposition, puis interrompt le développement mais, étonnamment, n’est pas reprise au début de la réexposition. Cela permet en fait à Beethoven de confronter deux logiques (variation et sonate), remarquable exemple de ces architectures hiérarchisées qui structurent les derniers quatuors.
L’Adagio constitue un des exemples remarquables de ces variations-métamorphoses qui sont une des acquisitions de la pensée beethovénienne. Au lieu de réinterpréter chaque fois l’ensemble du thème, les variations en font éclater le cadre s’emparant simplement parfois de quelques-unes de ses notes ou cellules qui servent alors d’argument de développement pour inventer un contour mélodique entièrement nouveau. Non seulement le thème est une des plus belles inspirations mélodiques du compositeur, mais il donne lieu ainsi à six variations et une coda en forme de méditation qui constituent un itinéraire spirituel d’une puissance visionnaire sans précédent. Ces variations sont ainsi les plus libres, et, avec celles de l’Opus 131, les plus audacieuses jamais écrites par Beethoven ; il faudra attendre Reger ou Berg pour trouver des textures plus foisonnantes. C’est en raison de cette richesse, de cette complexité mais aussi de la profondeur de pensée de cette page que nous la commenterons jusqu’à un certain niveau de détail en espérant donner au lecteur de bonne volonté quelques clefs d’écoute.
Le mouvement commence par une introduction de deux mesures pendant laquelle les quatre voix, entrant successivement (vlc, a, v2, v1), se fondent l’une dans l’autre – geste emblématique et métaphorique des qualités fusionnelles du médium-quatuor – avant que le thème ne se déploie au premier violon (mes. 3 [17’’]) en une longue phrase, somptueuse mélodie d’une haute spiritualité, imprégnée de la joie intérieure qui habite alors Beethoven – il vient d’achever l’Hymne à la joie –, joie profonde, saisie dans sa vibration la plus intime. Non pas joie de la jubilation, mais joie proche des « pleurs de joie » de Pascal. D’ailleurs, si, dans les variations du finale de la Neuvième Symphonie, Beethoven célèbre de multiples expressions de la joie, dans celles de l’Adagio de l’Opus 127, il semble explorer les diverses facettes, possiblement empreintes de gravité, de la joie telle qu’elle illumine la vie intérieure.
La première variation (mes. 21 [2’37]), une des plus surprenantes, semble poursuivre le déploiement du thème sans rupture et sans non plus de retour en arrière vers son origine – comme le veut le principe de la variation qui est censée réinterpréter le thème en en reprenant autrement le parcours. Partant d’une cellule germinale énoncée par le premier violon et lointainement dérivée d’un élément de ce thème, elle se révèle intensément effusive. Fondée sur une grande convergence des quatre voix, ici par excellence fusionnelles, l’écriture qui met en œuvre un contrepoint libre et complexe dessine un parcours, intensifie l’expression de la joie, en en saisissant la multiplicité mais toujours dans le ton d’un lyrisme fervent ; elle se tend vers des culminations qui sont autant de jalons jusqu’à l’ultime qui, au terme d’un crescendo, embrasse tout l’espace sonore du grave profond du violoncelle à l’extrême aigu du violon distants de six octaves (mes. 36 [4’43]). Puis la ferveur retombe et se fond dans le silence.
Par contraste, la deuxième variation, d’un tempo plus vif (Andante con moto mes. 38 [(5’20]) et de caractère ludique, consiste en un dialogue serré des deux violons – ils sont soutenus d’un bout à l’autre de la variation par des sortes de batteries des instruments graves – qui se répondent, s’imitent, se stimulent l’un l’autre, faisant assaut de virtuosité, de légèreté ailée, donnant l’impression d’un malicieux badinage où chacun improvise sous le regard et l’impulsion de l’autre. Au fur et à mesure du déroulement de ce dialogue, les dessins se complexifient et les lignes tendent à s’entremêler, avec notamment dans la dernière partie (mes. 53 [5’38]) l’apparition et la prolifération de trilles qui deviennent aussi des éléments du dialogue des deux violons. L’argument musical du jeu n’est autre qu’un motif constitué par les quatre premières notes du thème, énoncées sous une forme rythmique quelque peu saccadée et syncopée qui donne à cette page son caractère de joie bondissante.
Changement radical avec la troisième variation (mes.59 [7’06]), page presque immobile et à coup sûr extatique (Adagio molto espressivo), après l’élastique mobilité de la variation 2. Ici tout change, l’écriture se dépouille de tout ornement et rompt avec toute effervescence, mais non pas avec une certaine idée du lyrisme ni avec une nécessité cruciale d’intensification. Disposition sans précédent dans l’histoire de la variation, le paysage harmonique se transforme au début de cette page en « modulant » (passage de La bémol à Mi majeur) grâce à une enharmonie. L’auditeur se sent soudain soumis à une force hiératique, il se trouve plongé dans l’univers du sacré et poussé à la méditation. Partant des profondeurs immobiles de l’être (ancrage au départ dans les registres graves où se déploie une sorte de choral), cet Adagio molto monte « au-delà même du ciel étoilé, jusqu’à la source première », selon la formule de Romain Rolland. Comme on pourra le remarquer dans d’autres grandes pages métaphysiques du compositeur – comme l’Adagio de l’Opus 132 –, l’expression de la sérénité ou de l’hiératisme ne va pas sans une contrepartie de trouble ou de passion. L’impassibilité ou l’ataraxie ne sont qu’un moment du discours, souvent son point de départ, comme dans cette troisième variation de l’Opus 127, mais parfois son aboutissement, comme dans la coda du premier mouvement de ce quatuor et parfois aussi une sorte de moment de grâce inattendu, apparaissant soudain comme une divine surprise après un moment d’effervescence. Ici après un début comme « arrêté », le discours s’anime et s’intensifie jusqu’à une culmination passionnée (mes. 66 [7’56]), où tout l’espace se trouve à nouveau embrassé comme dans la culmination de la variation 1 ; puis l’élan retombe, le discours se concentre à nouveau dans le grave et semble se figer dans une posture hiératique avant de se tendre vers nouvelle culmination (mes. 74 [9’51]) d’une nature différente de la précédente (moins ivre de sa puissance et peut-être plus stable [accord parfait d’Ut majeur], mais quelque peu hallucinée dans le mouvement conjoint de violon 1 et du violoncelle vers leur registre suraigu), atteinte selon un autre cheminement et préparant une transition quasi mystique vers l’effervescente variation suivante.
Esthétiquement, cette quatrième variation (mes 77 [9’10]) qui retrouve le tempo et la tonalité de départ décline une nouvelle forme de légèreté ailée, faite d’envol mélodique vers l’aigu, mais aussi de palpitation et de volettement. Musicalement, après une introduction scandée par un motif de notes répétées, se conjuguent d’une part, la plénitude mélodique d’une phrase issue du thème que se transmettent le violon et le violoncelle (v1 [mes.78, 9’20], vlc [mes. 81, 9’45], v1 [mes. 85, 10’15], vlc, en homorythmie avec l’alto et le second violon [mes. 89, 10’41]) et d’autre part, une phrase ascendante d’arpèges, lancée par un trille et contrepointant la phrase principale. Au centre, les instruments médians construisent un troisième plan sonore en guise d’accompagnement. La merveille et disons le merveilleux de cette variation tiennent à cette conjonction de trois plans sonores différents, à la fois harmonieux les uns par rapport aux autres et chacun singuliers. Elle tient aussi à la manière dont, dans son évolution, le discours des voix extrêmes libère la palpitation du trille qui reste quasi-maître de l’espace lorsque la variation s’éteint dans un dialogue des deux violons (mes. 94 [11’18]).
Nouvelle stase avec la cinquième variation (mes. 95 [11’29]), d’une lumière plus sombre et construite sur une ample phrase jouée en imitation par le premier violon et l’alto. Elle est formée à partir d’un motif de quatre notes, issues du thème, dont la quatrième, tenue presque trois temps, semble à nouveau immobiliser le temps (comme les valeurs longues de la troisième variation) ; le lent égrènement de pizzicatos (mes 98 [11’46]) du second violon et du violoncelle, puis le moelleux balancement rythmique (noire-croche) de la phrase telle qu’elle se développe ensuite, créent une impression d’engourdissement quasi hypnotique qu’abolit à la fin de cet épisode un flux ascendant de trilles du premier violon (mes. 107 [12’52]) et qui conduit à ce que l’on peut considérer structurellement comme la deuxième partie de cette variation 5 – formant alors un diptyque hétérogène – mais que nous préférons interpréter comme une sixième variation, (mes 109 [13’04]) : à une joie que l’on peut qualifier de léthargique succède une joie sinon de la volubilité – car l’énonciation (figures de doubles croches) est moins rapide que celle de la variation 2 (figure de triples croches) – mais du « dire spontané ». « Spontané » car le flux mélodique semble couler de source. Pourquoi le « dire » ? Le thème, les variations 1 et 3 – et même la variation 5 – sont des sections réflexives, méditatives, tournées vers les profondeurs de l’âme, mais plus de l’ordre de la pensée que de la parole. Elles ne présentent pas, à proprement parler, de dimension narrative – comme on avait pu en trouver dans l’Andante de l’Opus 59 n° 3 –, elles n’adoptent aucune de posture oratoire ni ne proposent une quelconque mimesis de l’acte de parole. En revanche la variation 6, traversée d’un bout à l’autre par un flux ininterrompu de doubles croches – au premier violon d’abord, sur un accompagnement syncopé des autres des voix, puis aux trois voix inférieures (mes. 113 [13’31]) survolées par une sorte de pédale du premier violon, faite de sauts d’octave – renoue avec un style parlando que Beethoven avait exploré dans certains de ses dernières œuvres pour piano, comme la 31e des Variations Diabelli. La variation se termine sur une mesure d’une suprême élégance et d’un grand raffinement harmonique (mes. 117 [13’59]) où, après avoir « parlé », les quatre voix strictement homorythmiques semblent se pénétrer de la nécessité de se taire. Elles s’arrêtent comme en déséquilibre au bord d’un long silence. Ouverte par un train pianissimo de batteries, la brève coda (mes. 117 [14’12]) réintroduit le trille structural (dont le dessin de doubles croches de la variation 6, qui tournoie autour des mêmes notes, est une sorte d’extension-développement) puis conduit (mes. 122 [11’36]) une glose sur la clausule du thème (trois noires). Tout comme la monumentale Missa Solemnis, ce long mouvement (15’20) se termine alors de manière inattendue et assez abrupte sur une réinterprétation ritardando des premières notes du thème (mes. 126 [15’11]).
Le Scherzando vivace qui allie légèreté et puissance exalte comme jamais jusqu’ici la dimension ludique de l’écriture, les 145 mesures de la partie scherzo découlant d’un motif de quatre notes échangées sans relâche par les instruments selon une extraordinaire variété de combinaisons et de dispositions.
Quant au finale de caractère festif, il repose sur deux thèmes, une aimable ronde populaire et une danse frénétique avec ses notes martelées (mes. 55 [1’02]) et ses figures tourbillonnantes appelant au débordement carnavalesque. La mutation qu’opère alors la coda (mes. 256 [4’43]) est une des plus stupéfiantes : un long trille nous fait passer de l’autre côté du miroir dans un univers de l’ordre du merveilleux où tout n’est que timbre avec des textures frémissantes, des irisations sonores d’une infinie délicatesse, esthétique du clair-obscur et des lointains anticipant l’impressionnisme et Debussy, cela jusqu’à ce qu’un grand crescendo amplifie une variante majestueuse du thème de ronde populaire. Mais l’enchantement nous est encore offert à deux reprises avec la voluptueuse palpitation d’un pseudo-trille des trois voix supérieures (mes. 293 [6’39] et 295 [6’38]) avant les deux monumentaux accords finals.