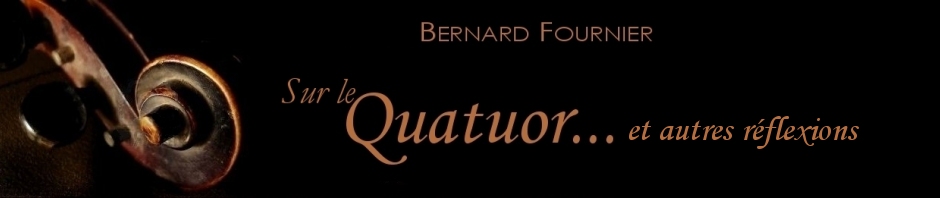Silence, Beethoven compose !
Essai sur la poétique du silence dans l’œuvre de Beethoven
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. »
Dans le premier chapitre du Livre de la Genèse, Dieu organise le chaos ou le tohu-bohu, selon l’expression hébraïque. Parmi tout ce qu’il accomplit en six jours, on ne trouve rien d’explicite qui concerne soit le silence, soit le bruit – hormis peut-être la mention du « souffle » de Dieu qui reste il est vrai ambiguë de ce point de vue, car peut–être ne s’agit–il que du souffle-esprit. Cependant, mais c’est de l’ordre de l’implicite, la formule litanique « Dieu dit » connote la parole et peut évoquer, à travers elle, le monde sonore.
Dans les chapitres suivants, outre la vue, présente dès les premiers versets du Livre par le truchement de la lumière, le texte illustre les catégories du toucher et du goût, mais la première notation explicite ayant trait à l’ouïe n’intervient qu’au chapitre 4, après le meurtre d’Abel. Youbal, un descendant de Caïn, y est désigné comme « le père de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte ». Curieusement, le son des instruments fabriqués par l’homme précède l’évocation des bruits de la nature, le murmure d’un ruisseau ou le chant des oiseaux. La référence à la musique constitue ainsi la première indication sonore qui suive la parole de Dieu puis celle de l’homme (Adam s’exprime verbalement au chapitre 3).
Dans son projet d’écrire une œuvre de musique, le compositeur se trouve, toute proportion gardée, dans la position de Dieu face au chaos primordial. Mais lui, il doit faire jaillir du silence un ensemble de sons organisés avec art , censés produire un sens et nous toucher. Car, selon Romain Rolland, la musique est « la parole la plus profonde de l’âme ».
Or parmi les éléments de plus en plus nombreux qui forment la palette des sons dont dispose le compositeur, le silence s’est imposé de tout temps comme une figure nécessaire autour de laquelle le discours musical s’organise. Les notations qui en définissent les durées sont d’ailleurs aussi différenciées que celles qui concernent les notes elles-mêmes, établissant une correspondance comme entre le vide et le plein ou entre l’ombre et la lumière.
Non seulement la musique part du silence pour y retourner, mais l’œuvre exige des respirations, petits silences d’articulation entre certaines phrases ou propositions, et elle recourt à des plages de silence plus ou moins longues qui, dans certaines œuvres contemporaines, peuvent occuper un place quasi équivalente aux plages sonores (Quatuor « Fragmentestille [Fragments de silence] » de Luigi Nono), voire l’entièreté même d’une pièce (4’33 de John Cage).
Dans cet itinéraire qui va d’une musique toute pleine de sons à une musique du silence, Beethoven occupe un rôle essentiel. Sa musique témoigne d’une véritable poétique du silence qui met en œuvre différents types de silence exerçant différentes fonctions esthétiques.
I – ENTRE LE SILENCE PRÉCÉDANT L’ŒUVRE ET L’ŒUVRE EN ACTION, L’INTRODUCTION-NARTHEX.
Dans les esthétiques classique, romantique et même postromantique, une œuvre instrumentale commence en général par un mouvement rapide, un allegro dit de « forme sonate », premier volet de son architecture en quatre mouvements. Mais Haydn et Mozart ajoutent parfois avant cet allegro une introduction lente de caractère en général grave et qui a fonction de prélude.
Chez Beethoven, l’introduction va prendre une grande importance et jouer un rôle fondamental aussi bien dans l’économie discursive que dans la stratégie expressive et par conséquent le rapport à l’auditeur.
Bien que le compositeur n’ait rien verbalisé à ce sujet, on ne peut pas ne pas penser qu’il a puissamment réfléchi au rapport qu’entretiennent silence et musique et qu’il a cherché différentes manières de passer de l’un à l’autre, une fois résolu – socialement – le problème du passage du bruit de la salle au silence nécessaire qui précède l’écoute de l’œuvre.
Au concert, avant que l’œuvre ne commence, on est habitué aujourd’hui à ce que le public fasse silence et se prépare à l’écoute. Mais ce n’était pas toujours le cas et on se rappelle qu’au XVIIIe siècle, devant écrire des quatuors (Opus 71 et 74) pour des concerts londoniens , Joseph Haydn avait fait débuter ses œuvres par des gestes forts censés attirer d’emblée l’attention du public et mobiliser son écoute. Conscient, lui aussi, de cette nécessité, Beethoven exige davantage encore. Il empoigne l’auditeur et le soumet à l’écoute par des gestes forts et implacables, pensons au premier accord dissonant de la Ière Symphonie et au début, si célèbre, de la Ve. Mais de même que l’orateur qui veut obtenir le silence d’un auditoire bruyant baisse la voix, Beethoven peut faire débuter ses œuvres dans une nuance tellement piano qu’il faut tendre l’oreille, se concentrer (Quatuor opus 18 n° 3, Quatuor opus 74, quatre des cinq derniers quatuors).
Imaginons maintenant le public silencieux, concentré, tendu vers le début de l’œuvre, ce qui est la situation du concert. Il s’agit alors de transformer le silence en musique et, pour ce faire, Beethoven montre une inventivité stupéfiante. Il écrira ainsi au cours de sa carrière des dizaines de variations sur le thème : « comment faire passer du silence de l’attente à la musique en action ».
Bien que toutes différentes les unes des autres, les solutions qu’il imagine ont à voir avec la fonction de narthex dans les édifices religieux. Avant que les fidèles ne pénètrent dans l’église, la cathédrale, la basilique, les bâtisseurs du Moyen Âge ont parfois ajouté à l’édifice, après le porche, un vestibule où l’on puisse faire silence et se recueillir avant de pénétrer dans la nef. C’est le cas exemplaire de la basilique Marie-Madeleine de Vézelay. Il s’agit en fait de mettre l’accent sur la qualité sacrée du lieu auquel on va accéder. Et il en est de même pour la signification de nombre d’introductions beethovéniennes.
Nous en évoquerons deux de caractères opposés, prises dans le cycle des quatuors.
-L’une, celle du 9e, l’Opus 59 n° 3 (Troisième quatuor « Razoumovski ») nous fait passer progressivement, en plus de deux minutes et en deux grandes étapes (d’abord un Andante poignant, puis un récitatif exploratoire), de l’ombre à la lumière ; de la lenteur quasi immobile à la vitesse ; d’un discours troué de silences dont la direction est incertaine à un flux continu et résolu ; de l’inquiétude fiévreuse à la libération jubilatoire.
-L’autre, celle du 12e Quatuor opus 127, un Maestoso, tout de magnificence sonore avec ses accords puissants et ronds, fait figure de narthex majestueux qui permet de pénétrer non seulement cette œuvre mais dans l’univers des dernier quatuors.
On pourrait trouver – et cela dès les premières œuvres –, les mêmes types de dispositions dans presque tous les genres instrumentaux, mais toujours tellement personnalisées et pensées dans le contexte particulier de l’œuvre en question qu’il s’agit chaque fois d’une démarche nouvelle. Ainsi en est-il des sonates pour piano (exemples, Sonate opus 31 n° 2 « La Tempête », Sonate opus 111), sonates en duo (Opus 5 [violoncelle et piano], Opus 47 « à Kreutzer »), des trios avec piano (Opus 1 n° 2, Opus 70 n° 2, ou des symphonies (n° 4, n° 7) pour citer les cycles les plus prestigieux.
Hormis leur rôle de narthex dans leur rapport au bruit et au silence, ces introductions toujours plus lentes que le discours du mouvement qu’elles précèdent, se révèlent souvent de caractère réflexif : Beethoven s’y interroge sur les événements musicaux à venir.
L’œuvre de Beethoven montre, nous l’avons suggéré, que pendant toute sa carrière le compositeur s’est posé le problème du passage du silence à la musique sans se contenter de la laisser simplement apparaître pour qu’elle puisse ensuite suivre son cours selon les règles établies, mais il l’a fait en véritable alchimiste transmuant le silence en son. De même qu’il s’interroge sur les multiples manières de mettre en scène l’émergence de la musique, de même il se pose à la fin de l’œuvre le problème du passage de la musique au silence. Mais les résultats se révèlent moins divers, même si on trouve un large éventail de procédures de ralentissement de tempo ou plus précisément de nombreuses modalités d’insertion, dans les codas des mouvements vifs qui concluent les œuvres, de sections de tempos plus lents qui peuvent elles-mêmes comporter des silences. Mais, même dans ses œuvres les plus sombres, Beethoven ne terminera jamais une partition par une section lente et par un decrescendo vers le silence, ce qui ne se produira qu’à partir du début du XXe siècle lorsque les compositeurs s’affranchiront de la tradition de terminer une œuvre de manière brillante et en apothéose sonore. Pensons au 2e Quatuor de Bartók ou à la Suite lyrique d’Alban Berg où l’alto seul répète diminuendo puis morendo un motif qui s’éteint si bien que la musique retourne naturellement au silence. La fin de la Sonate opus 111 mérite cependant d’être signalée puisque l’Arietta, second (et dernier) mouvement de tempo lent, se termine sinon morendo du moins pianissimo ouvrant la voix aux conquêtes contemporaines dans ce domaine.
Beethoven est sûrement un des premiers compositeurs qui se montre conscient de l’importance qu’il faut attacher au début et à la fin de l’œuvre non seulement pour des raisons circonstancielles ou pour des raisons relatives à la conduite et à la cohérence du discours, mais pour l’importance de la question du passage du bruit de la vie à la musique de l’œuvre, question quasi philosophique qui touche à l’ontologie de la musique et à l’ontologie du silence et que Beethoven traite non pas en compréhension bien sûr, mais en extension et cela avec une multiplicité de propositions toujours ingénieuses, souvent innovantes et parfois géniales. Ingénieuses, innovantes, géniales, c’est aussi ce qu’on peut dire des différentes façons dont le compositeur utilise le silence dans l’œuvre instituant une véritable poétique du silence par laquelle cette figure non seulement acquiert un rôle expressif d’une riche diversité mais se révèle porteuse de significations puissantes notamment lorsqu’elle agit en relation avec des dispositions formelles.
II – RÔLES ET FONCTIONS DU SILENCE DANS L’ŒUVRE
Le silence fait partie du matériau de base dont dispose le compositeur pour construire son œuvre. Il est un des éléments du vocabulaire musical.
Parmi les nombreux types de silence qui jalonnent les œuvres de Beethoven, certains se trouvent aussi dans la musique de ses prédécesseurs, d’autres introduisent des fonctions extrêmement nouvelles soit du point de vue expressif (angoisse, par exemple), soit du point de vue narratif (ellipse) ou de la structuration du discours. Mais même dans les catégories de silence explorées par ses prédécesseurs, Mozart et Haydn notamment chez qui elles apparaissent déjà, Beethoven introduit une dimension nouvelle et de nouvelles significations esthétiques.
II – 1 FONCTIONS EXPRESSIVES DU SILENCE
Compte tenu de sa nature, la fonction la plus traditionnelle et la plus attendue du silence consiste en respiration et ponctuation. Il aère les phrases et en marque les limites, tenant lieu dans un texte musical de virgule, de point virgule (entre deux propositions d’une même phrase), de point. Nous ne commenterons pas ce type de silences qu’on trouve dans toutes les musiques.
Mais il peut aussi – et cela entre dans une perspective expressive – jouer le rôle d’un point d’interrogation ou d’un point d’exclamation. Le lecteur les identifiera facilement par analogie à celui du Grave introductif au Finale de l’Opus 135, dont le motif initial est explicitement assimilé à une question (Muss es sein? Le faut-il ?), comme Beethoven le note dans le paratexte de l’œuvre, suivi au début de l’Allegro de sa réponse : Es muss sein! (Il le faut !). Inquiétude de la question qui s’exacerbera au fil du discours, joie naïve de la réponse qui, à l’inverse se ternira en laissant place au doute.
Mais le silence peut marquer aussi la séparation, voire la rupture radicale entre deux univers expressifs très différents représentés alors par des blocs contrastés.
II – 1 – 1 Silences séparant des univers musicaux opposés
Tous les paramètres s’inversent alors soudain, intensité (ff pp), densité (toute la masse orchestrale une simple ligne instrumentale toute frêle), tempo (Allegro-Adagio), harmonie (majeur-mineur), etc., si bien qu’on est projeté en un instant et comme d’un coup de baguette magique d’un paysage expressif dans un autre qui lui est tout à fait étranger.
Ces blocs de polarités inverses qui s’opposent peuvent être directement juxtaposés [descendit de coelis – Et incarnatus du Credo de la Missa Solemnis], mais ils sont parfois liés par un point d’orgue (Ier mouvement de l’Opus 130) ou séparés par un silence.
Cette dernière disposition crée pour l’auditeur une situation d’attente de suspens où sa conscience auditive est libre de rêver, incitée peut-être à imaginer.
Nous prendrons deux exemples de ce type de situation mais dans lesquels la fonction du silence diffère notablement de l’un à l’autre malgré des contextes semblables.
1 – Ouverture de Fidelio opus 72 en Ut ; réorientation, ressourcement
Cette ouverture – la quatrième composée par Beethoven pour Fidelio – ne fait appel à aucun thème de l’opéra qu’elle introduit et cela contrairement aux trois précédentes (Léonore I, II et III). Mais elle présente d’emblée, séparés par un silence, les deux principaux univers musicaux de l’opéra associés eux-mêmes aux deux types d’affect qui animent le personnage principal sous son double rôle d’homme et de femme, l’héroïsme de Fidelio et l’amour tendre de Léonore.
L’ouverture commence en effet par une sonnerie puissante et énergique de caractère héroïque jouée par tout l’orchestre homorythmique . Le silence de la mesure 4, à quelques secondes du début, précède une sorte de rêverie amoureuse des cors. Ainsi le silence se révèle orienté : il conduit du vif au lent. Mais également il structure une opposition entre deux blocs contrastés et indépendants : il assure la transition entre une séquence A massive, active avec son tempo rapide et son rythme saccadé et une séquence B ténue, contemplative, de tempo lent et au rythme lisse. A est joué par une quinzaine de pupitres instrumentaux tandis que B n’est confiée d’abord qu’aux seuls cors puis aux clarinettes accompagnées des cors. Si le déroulement de B est alors arrêté abruptement – sans silence de transition – par le retour soudain de A (mes. 13), en revanche A n’est pas interrompu par un élément sonore et il semble même ne pas pouvoir l’être étant donné sa dynamique irrésistible et son caractère impératif. En outre, pour que B puisse sourdre dans toute la délicatesse de son piano dolce, il est nécessaire que s’interpose un silence de transition dont on s’aperçoit qu’il fait aussi figure de lieu et d’espace de ressourcement d’où va émerger la mélodie des cors.
Au-delà de sa simple fonction de changement de décor, le silence qui suit la séquence héroïque revêt une signification esthétique, voire psychologique, d’intériorisation et de poétisation.
II – Andante con moto du IVe Concerto pour piano opus 58 : réorientation, transformation
Dans le 2e mouvement du IVe concerto, un silence sépare également deux blocs A et B représentant des paysages musicaux situés aux antipodes : un puissant unisson farouche et impérieux à l’orchestre staccato dans la nuance forte (A), d’une part, et, d’autre part au piano, une ligne discrète legato d’accords molto cantabile puis molto espressivo de caractère tendre et recueilli, dans la nuance pianissimo (B).
Ex. 1 : IVe Concerto pour piano, Andante, mes. 1-13
Une fois exposées les deux premières répliques de ce dialogue – l’affirmation péremptoire de l’orchestre puis, après un silence et en guise de réponse, l’énoncé tout de sérénité et d’équanimité du piano dont le chant semble hors d’atteinte du bruit et de la fureur du monde –, le mouvement va inverser peu à peu la polarisation esthétique initiale en agissant sur le poids du silence et sur la nature énoncés.
Dans ce dialogue où orchestre et piano s’affrontent, le silence posé comme frontière entre des territoires adverses (mes. 5, 13, 19), est bientôt grignoté par A. En effet, à la mesure 26, l’orchestre forte sempre staccato empiète sur la conclusion de la phrase du piano.
Ex. 2 : IVe Concerto pour piano, Andante, mes. 25-30
Le dialogue, jusqu’ici bien ordonné en énoncés séparés, revêt alors une forme plus entrelacée : chaque début d’énoncé se superpose à la fin de l’autre ou le suit sans césure.
L’orchestre, peu à peu, perd de son ardeur (diminuendo jusqu’au pianissimo) tandis que le piano, inaltéré, resté seul maître de l’espace musical, finit par abandonner la ligne mélodique qu’il suivait sans faillir, pour se livrer à une sorte de cadence réflexive tourmentée. Après deux accords arpégés, ponctués chacun d’un silence éloquent, l’orchestre, dompté, fait sa rentrée, ppp, laissant enfin le piano conclure seul.
Beethoven met ici en scène une dialogue de type confrontation où la position des interlocuteurs évolue nettement : l’orchestre d’abord affirmatif et conquérant renonce à sa pugnacité dominatrice pour en arriver même à une formulation hésitante. Tandis que l’orchestre perd peu à peu de sa force, le piano, hormis la cadence centrale où la passion se libère, maintient inaltérée sa posture rêveuse et réservée.
Dans cette page admirable de concentration et d’expressivité, gorgée de significations d’arrière-plan, le silence joue un rôle fondamental. Il apparaît comme une sorte d’enjeu du dialogue, comme un territoire à préserver ou à conquérir par les protagonistes.
Dévoré à la mesure 26, par un orchestre quasi impérialiste, il est restitué et magnifié au terme de la cadence du piano qui le reconquiert et l’impose maintenant à l’orchestre : après les deux accords arpégés du piano (mes. 62-63), l’orchestre attend non seulement la durée canonique du début de l’œuvre, mais deux fois cette durée pour faire une entrée maintenant timide et hésitante, soumise.
Ex. 3 : IVe Concerto pour piano, Andante, mes. 62-66
Renversant finalement les rôles, c’est le piano qui, à son tour, empiète sur le silence de l’orchestre à la mesure 69 avant de conclure seul (mes. 72).
Avec cet Andante du IVe Concerto, nous avons l’exemple d’un silence considéré comme une cellule vivante, comme un objet musical pris dans la dynamique du discours et soumis à un jeu de transformations, au même titre que tout autre élément du lexique.
Ce qu’il est intéressant de noter ici du point de vue de la pensée beethovénienne, c’est que ce combat dont l’espace du silence est un enjeu oppose deux protagonistes qui ne disposent pas des mêmes armes. L’impétueux orchestre est comme Minerve sortant tout armée de la cuisse de Jupiter ; ses attributs sont la puissance et la percussivité. Le piano n’est que douceur et tendresse, même dans sa véhémence passionnée. Si l’on est tenté de revenir à des stéréotypes selon lesquels Beethoven aime opposer le masculin et le féminin, il apparaît ici, d’une part, que le compositeur visionnaire savait exprimer le féminin au cœur de l’image du masculin aussi bien que le masculin au cœur du féminin et que d’autre part dans ce que l’on peut considérer comme une lutte du masculin et du féminin, c’est bien évidemment le féminin qui l’emporte par la force discrète de son intériorité tendre.
II – 1 – 2 Silences trouant les lignes mélodiques
De conception apparemment moins originale que les silences séparant les blocs, les silences jalonnant certaines lignes mélodiques peuvent néanmoins jouer chez Beethoven un rôle puissamment original. De prime abord, ils apparaissent comme des éléments de diction de la phrase, mais en fait ils en infléchissent nettement le caractère et la signification.
Le silence comme expression musicale du corps souffrant, suffoquant
Parmi les nombreux exemples possibles , nous en décrirons deux qui présentent à la fois
un contenu expressif semblable, celui de l’angoisse – c’est en tout cas ce que Beethoven indiquait très clairement vouloir obtenir –, une évolution sensible au cours de la séquence envisagée, permettant d’examiner le rôle dynamique du silence dans l’écriture. Dans les deux cas – la Cavatine du 13e Quatuor opus 130 et l’Arioso dolente de la 30e Sonate opus 110 – le silence présente un caractère haletant, oppressé, angoissé.
Cavatine de l’Opus 130
Dans la Cavatine, cinquième mouvement du 13e Quatuor, le centre B du mouvement (mesures 40 à 47) de forme ABA’ est occupé par un épisode noté explicitement beklemmt (oppressé, angoissé). Ce passage, qui n’entretient aucun lien thématique avec les parties extrêmes A et A’, s’avère structuralement indépendant du reste du mouvement. Il se singularise d’emblée par l’apparition d’une texture nouvelle, une batterie continue (ostinato) de triolets de croches (figure absente des parties extrêmes) aux trois instruments graves (violon 2, alto violoncelle) qui sous-tend les 8 mesures de ce passage :
Mais le plus étonnant n’est pas là.
Sur cette trame, dont la densité ne cesse d’ailleurs de croître (3 croches superposées puis 4 puis 5), le premier violon énonce une phrase notée beklemmt dont les figures rythmique de doubles croches se situent souvent en porte-à-faux avec les croches de triolets de l’accompagnement. L’instabilité de cette ligne, proche de l’ataxie, est d’autant plus impressionnante qu’elle est mise en regard de la forme inexorablement stable et de la régularité de la texture. En outre la ligne est comme trouée, déchirée par des silences de plus en plus brefs et nombreux, comme l’indique la liste ci-dessous donnée à titre indicatif
– mesure 40 1 pause
– mesure 41 1 soupir
– mesure 42 2 demi-soupirs
– mesure 43 3 demi-soupirs
– mesure 44 1 demi-soupir et 1 quart de soupir
– mesure 45 4 quarts de soupir
– mesure 46 4 quarts de soupir
Ex. 4 : 13e Quatuor opus 130, Cavatine, mes. 40-48
Cette accélération de la fréquence des silences qui vont à la fois en se resserrant et en se multipliant induisant un émiettement de la ligne contribue à accentuer le sentiment de souffrance angoissée que Beethoven souhaitait exprimer. Le symptôme le plus névralgique de la crise d’angoisse se révèle sans doute dans quatre groupes de deux triples croches homonymes (même note) présentées dans une même liaison (mes. 46) et séparées par un quart de soupir. Le phrasé suppose que la même note soit réénoncée une deuxième fois avec la même prise d’archet , mais de manière assourdie, comme une deuxième expiration sans inspiration, portant jusqu’à l’étouffement le caractère haletant de toutes les figures.
Ici, la souffrance n’est donc pas seulement évoquée, suggérée, représentée, métaphorisée par le discours ; elle est, à proprement parler, injectée, appliquée à cette forme vivante qu’est la phrase musicale dont le geste devient, dans son essence même, souffrance. La musique est comme assimilée à un corps humain souffrant d’angoisse : elle halète, suffoque, étouffe, cherche son souffle comme lui . Remarquons notamment cette inspiration soulignée par le crescendo qui accompagne les 3 doubles croches liées de la mesure 45 : après toute la période précédente de plus en plus saccadée, le discours reprend son souffle.
Nous voyons bien que, dans cette page, le silence joue un rôle-clef : il alimente ce qui, dans le discours, échappe à une énonciation atone (la chaîne ininterrompue aux trois voix graves des triolets à la sonorité blanche) et constitue le ressort, l’influx énergétique de la phrase du violon I, accablée mais frémissante.
La forme ABA (ABA’) de ce mouvement met en évidence le contraste radical des deux parties A et B : on passe d’une méditation névralgique mais contenue (A) à une manifestation quasi physique du trouble de l’âme (B). L’apparition de la partie centrale se signale d’abord par un effondrement subit de l’étiage du discours (pianissimo soudain des batteries, mes. 40, suivant lui-même un petit crescendo, geste emblématique chez Beethoven annonçant souvent, par une sorte de charge émotionnelle, la survenue d’un « événement » musical. Il consiste en l’occurrence en une mutation de sa fonction expressive.
Au chant grave et douloureux de A dans la plénitude de sa ligne cantabile, succède une phrase (B) hachée, entrecoupée de soubresauts, en partie muette avec ses silences proliférants qui attisent le sentiment d’angoisse en brisant de plus en plus la continuité mélodique.
Le discours de cette Cavatine – jamais page n’aura mieux mérité ce titre – creuse dans l’espace, creuse en son sein pour atteindre, dans les profondeurs, le frémissement inexprimé qui, en amont de la parole et du cri, fait vibrer le pur silence.
Le retour de la partie A apparaît alors comme une libération, une restauration de l’ordre musical – la continuité mélodique – après le désordre de l’exprimable après l’indicible.
Arioso dolente de la Sonate de l’opus 110
Le deuxième exemple, que nous emprunterons à la Sonate opus 110, nous permettra de mettre en relief une autre utilisation tout aussi puissante et impressionnante du silence dans une phrase mélodique qu’il interrompt et morcelle, se révélant un agent de l’expression musicale de la souffrance qui fait haleter, suffoquer.
Le Finale de cette sonate commence par une longue et belle introduction qui traverse différents tempos lents (sept changements de tempo ) avant de déboucher sur la fugue, Allegro, partie principale du mouvement dont le thème, construit sur des quartes ascendantes, représente selon Beethoven le combat intérieur de l’homme contre la douleur. Cette fugue est immédiatement précédée d’une séquence de tempo Adagio ma non troppo (tempo initial du mouvement) caractérisée par la notation expressive Arioso dolente (Chant de plainte) et construite sur un thème d’une émotion poignante :
Ex. 5 : 31e Sonate opus 110, Arioso dolente, mes. 9 – 13
Au centre de la fugue, cet Arioso dolente réapparaît avec deux modifications principales :
D’abord, et à l’instar de ce qu’il fera dans la Cavatine, Beethoven éprouve le besoin de recourir à une explicitation verbale de ses intentions expressives. Il note en allemand et en italien : Emmattet, Klagend ; perdendo la forza, dolente (en perdant de la force, dolent) au moment où le thème de l’Arioso dolente est réintroduit, notation quasi physique, corporelle à rapprocher du beklemmt (angoissé, oppressé) de la Cavatine de l’Opus 130.
Ensuite, et surtout, reposant sur les mêmes strates de triolets de doubles croches à la main gauche que celles du premier Arioso – triolets qui ne peuvent pas cacher leur parenté avec ceux de l’Opus 130 –, la mélodie réapparaît maintenant trouée de silences (huitièmes de soupirs, quarts de soupirs) qui lui donnent un visage entièrement nouveau, une respiration haletante, oppressée. Beethoven ne joue pas ici, comme dans la Cavatine, sur une progression rapide et irrépressible de l’angoisse, à proportion de l’accroissement de la densité des silences. En effet, la configuration des silences ne change guère de nature et d’intensité pendant les 10 premières mesures ; mais, dans les dernières, en revanche, les silences dévorent progressivement le champ sonore jusqu’à occuper 8 temps sur 12 dans la 17e mesure et à rester maîtres de l’espace dans la 18e :
Ex. 6 : 31e Sonate opus 110, L’istesso tempo di Arioso, mes. 116-120
C’est alors que se situe un épisode emblématique à la fois puissamment expressif et hautement significatif : par une série de dix accords homonymes, entrecoupés chacun de deux quarts de soupir, accords dont la densité augmente progressivement de 4 à 8 en même temps que l’intensité s’accroît, Beethoven vient non seulement signifier mais acter que l’énergie se rassemble, que les forces se remobilisent :
Ex. 7 : 31e Sonate opus 110, L’istesso tempo di Arioso, mes. 132-137
L’énergie qui se déploie ici construit une sorte de puissante digue qui vient arrêter le flux dépressif de l’Arioso porté juste avant à sa déchirante culmination névralgique. Cette digue marque, non seulement symboliquement mais dans la matière musicale elle-même, le refus de l’état de douleur auquel on vient de s’abandonner. Les doux arpèges legato qui montent ensuite diminuendo des graves vont introduire la réexposition de la fugue dans la lumière sereine de Sol majeur et sous une forme descendante apparaissant comme une sorte de don.
Le message, assez lisible, de ce passage est très proche de celui d’un parcours expressif des quatre mouvements de la future IXe Symphonie. La douleur est le lot de l’homme (Arioso dolente), il doit en accepter l’idée mais la combattre, de toutes ses forces (digue d’accords) puis s’y soustraire en se plaçant dans une disposition d’esprit réflexive ou méditative (arpèges ascendants, inversion de la fugue), ouvrant alors à la joie (coda).
Musicalement, les accords permettent une ré-acquisition de l’espace (même au sommet de leur puissance, les accords restent cantonnés dans le registre grave) en forme de respiration (arpèges) puis le retour de la fugue en rétrograde, avec la notation – Poi a poi, nuovo vivente (en revenant peu à peu à la vie) :
Ex. 8 : 31e Sonate opus 110, L’istesso tempo della fuga, mes. 137-143
Dans la suite d’accords de l’exemple 7, les silences ne jouent pas un rôle analogue à celui que nous avons décrit jusqu’à présent. L’indication de pédale a pour conséquence que le silence, qui sépare chacun des accords du suivant ou du précédent, est en fait absorbé par un phénomène délibéré de résonance. Beethoven a clairement indiqué qu’il souhaitait à la fois l’impact de l’accord – celui qui est dû à son attaque – et la résonance de cette attaque sur les deux temps prévus à cet effet. La résonance, mentale le plus souvent, que contribue à créer le silence, se traduit, dans ce cas, en une véritable résonance, au sens physique.
Nous nous trouvons donc ici en présence d’un autre type de perspective sur le silence. Au lieu de l’envisager comme un élément qui permet de trouer la phrase musicale, en s’opposant à la nature même des objets sonores de sa ligne, de la déchiqueter, Beethoven l’utilise ici comme antithèse du son dans une relation – non plus d’antagonisme mais de complémentarité – qui fait surgir la résonance comme produit des deux termes, son et silence.
Cette utilisation très moderne du silence comme valeur en soi, son aspect dynamique, proliférant, son rôle stratégique dans l’organisation du discours, son intégration radicale dans le tissu musical au point de devenir la substance même de la musique, sa quintessence expressive, tout cela peut faire penser à la manière dont, cinquante ans plus tard et dans un tout autre domaine, Cézanne exploitera le blanc – non pas en tant que couleur, mais en tant que matière, la matière même du papier (ou de la toile) – par exemple dans certains dessins qu’il fit de la Montagne Sainte-Victoire.
II – 1 – 3 Silence-amplification, silence tension
Le silence peut contribuer à l’amplification d’un phénomène. C’est ce que nous avons vu, avec le Finale de l’Opus 110 dans le cadre d’un phénomène multiple et complexe, avec la digue des dix accords de qui, tout en rompant avec l’atmosphère de l’Arioso dolente se chargent peu à peu d’énergie à la faveur des silences qui les séparent.
Premier mouvement de la Quatrième symphonie
Un exemple plus simple et plus univoque est donne par le début de la IVe Symphonie.
À la fin de la longue introduction lente (Adagio) et méditative du premier mouvement et juste avant l’irruption du roboratif Allegro vivace débordant de joie et d’énergie, un crescendo mène en une mesure de la nuance pianissimo jusqu’au fortissimo qui sera celui de l’Allegro. Ce crescendo se développe en fait sur quatre croches entrecoupées de soupirs :
Ex. 9 : Quatrième Symphonie, Adagio, mes. 32-38
Chaque croche doit se trouver de fait sur un palier différent d’intensité ; les silences qui les séparent joue alors en quelque sorte un rôle d’accumulateur d’énergie, chaque nouvelle croche se situant à un niveau d’intensité supérieur à la précédente. Contrairement au type précédent de silences qui avaient une valeur essentiellement expressive sans action de transformation discursive, ceux-là sont silences actifs, effecteurs, performatifs qui prolongent et amplifient un phénomène organisé et orienté.
Ce procédé sera repris plus tard, certes avec plus de force expressive encore, mais dans le même esprit par Richard Wagner, dans la Marche funèbre du Crépuscule des Dieux.
Adagio affetuoso ed appassionato du Quatuor opus 18 n° 1, coda
Un autre exemple, pris une dizaine de mesures avant la fin de l’Adagio du 1er Quatuor, montre comment le silence crée et entretient une tension dans un processus sempre forte qui conduit, sans crescendo, à une soudaine culmination ff, libération de toutes les tensions précédemment accumulées par les silences successifs.
Dans la coda de ce mouvement, le thème repris au violoncelle en faisant alterner des mesures p crescendo ou simplement piano et des mesures forte, elles-mêmes soulignées par de puissants tourbillons à base de triples croches aux deux violons.
À la septième mesure de son chant (mes. 102), le violoncelle suspend son énoncé et s’arrête sur une noire tout comme les instruments médians tandis le violon 1 lance une première fusée tourbillonnante tendue vers l’aigu et qu’arrête un silence deux temps (six demi-soupirs, soit quelque trois secondes), puis une deuxième et une troisième fusée, chacune toujours plus haut et cette dernière étant suivie de la libération culminative qui se traduit par l’affirmation de la nuance ff sur la note-cible du violon fa5 [la plus aiguë du violon dans ce mouvement] et sur les trémolos des trois autres instruments.
Ex. 10 : Quatuor opus 18 n° 1, Adagio affetuoso ed appassionato, mes. 100-105
Pendant la durée de chacun des trois silences des mesures 102, 103, 104, le discours reste en suspens dans l’attente de ce qui va survenir, chacun de ces moments se situant à un niveau de tension supérieur au précédent en raison d’une sorte d’effet cumulatif. Certes c’est bien un élément sonore qui crée la tension, la fusée tourbillonnante du violon 1. Après son arrêt net, c’est le long silence qui non seulement maintient mais intensifie cette tension et ce en situation de concert d’autant plus que les instrumentistes maintiennent une attitude en tension (pas de relâchement du geste de l’archet).
II – 1 – 4 Silences décompression, silence détente
À l’inverse, le silence peut contribuer à ramener le calme en jouant un rôle apaisant. Il s’avère alors souvent déterminant dans les logiques de décroissance, dans les processus qui ont pour fonction de réduire l’intensité, de diminuer les tensions. On en trouve maints exemples.
Adagio affetuoso ed appassionato du Quatuor opus 18 n° 1, développement
Un des plus spectaculaires, notamment par l’ampleur de la durée silences (presque 5 secondes pour chacun) – que les interprètes ont hélas parfois tendance à écourter –, se trouve lui aussi dans l’Adagio du 1er Quatuor, un mouvement qui en regorge, et de types différents, si bien qu’il permettrait à lui seul d’esquisser une poétique du silence beethovénien. À la fin du développement, après une période intense et véhémente où sont introduites et exacerbées les figures tourbillonnantes qui serviront dans la coda, Beethoven conclut en faisant retomber la fièvre par quatre mesures commençant chacune par un accord de noire, respectivement f, p, pp et ppp suivis chacun d’un silence de 2 temps un tiers. L’intensité décroît donc radicalement par palier et dans ce processus les silences jouent un rôle essentiel. Ils résonne de la sonorité de l’accord qui les précèdent puis en absorbent une partie de l’intensité sonore provoquant une déperdition qui se manifeste dans l’accord suivant.
Ex. 10 : Quatuor opus 18 n° 1, Adagio affetuoso ed appassionato, mes. 58-62
Nous donnerons un deuxième exemple plus élaboré et plus riche de conséquences pour l’architecture générale de l’œuvre dans sa relation avec la visée expressive à grande échelle.
Allegro de la Sonate opus 111, coda
Composée en 1821-1822, l’ultime sonate de Beethoven pour le piano est généralement considérée comme son chef-d’œuvre du genre. Conçue en deux mouvements, elle oppose un Maestoso-Allegro en ut mineur extraverti, d’une rare puissance dramatique, et une Arietta en ut majeur profondément intériorisée et visionnaire. L’œuvre a véritablement été pensée comme un diptyque qui exprime deux pôles antithétiques de la nature éminemment dialectique de Beethoven. C’est une occasion de savourer l’humour de la réponse de Beethoven à Schindler qui l’interrogeait sur la raison pour laquelle la sonate ne comportait que deux mouvements : « Je n’ai pas eu le temps d’écrire un troisième mouvement ». En fait un mouvement supplémentaire n’aurait pu que déséquilibrer l’œuvre dont l’architecture construit un itinéraire expressif totalisant (une totalité expressive).
En effet, il ne s’agit pas seulement de deux mouvements qui s’opposent terme à terme (dramatique/lyrique, mineur/majeur, actif/méditatif, extériorisé/intériorisé, pugnace/rêveur, etc.) mais d’un itinéraire spirituel d’univers expressif à un autre, qui, en outre, résout un problème esthétique qui hantait Beethoven depuis les années 1800 et la crise de la surdité dont nous avons cherché à montrer à plusieurs reprises qu’elle trouvait musicalement son point d’application dans les œuvres écrites dans la tonalité d’ut mineur. Or les caractérisations esthétiques que Beethoven attache à cette tonalité qu’il place au centre de son écriture dramatisante vont être transfigurées dans l’Opus 111 : le violent ut mineur se transmue souplement en Ut majeur dans la coda du premier mouvement installant ainsi le tonalité du second. Après ce geste bref mais d’une force et d’une signification capitales, Beethoven n’écrira plus en ut mineur et, lorsque par exception il le fera, il donnera une tout autre couleur expressive à cette tonalité, comme dans la 31e des Variations Diabelli opus 120 où l’âpreté au combat fait place à une méditation mélancolique.
À la fin du premier mouvement de la sonate un ultime coup de rein du Beethoven-combattant conduit à une culmination ff sur une octave de do (do4 à la main gauche, do6 suraigu à la main droite, note la plus aiguë du mouvement), point d’aboutissement d’une rageuse montée chromatique scandée par des sforzandos violents sur chaque temps. S’enchaîne alors une série de huit accords quasi syncopés (sur les temps faibles de la mesure) de noires, séparés les uns des autres par un silence (un soupir). Les quatre premiers toujours ff sont soulignés par un sforzando (accent) tandis que les quatre suivants, affecté d’un point (durée des noires plus courte) sont pris dans un decrescendo qui mène à piano. Non seulement la fièvre s’éteint avec l’intensité qui diminue comme dans l’Opus 18 n° 1, mais il se produit une véritable mutation harmonique et expressive, les dernières mesures en Ut majeur étant empreinte d’une ineffable douceur.
Ex. 11 : Sonate opus 111, Allegro con brio ed appassionato, coda, mes. 144-150
II – 2 SILENCE ET STRUCTURATION DU DISCOURS
Parmi les nombreux types de silence dont la mise en jeu intéresse la structuration du discours, nous en relèverons deux. Le premier est relatif à la présentation initiale du matériau de base, c’est-à-dire aux éléments thématiques ou motiviques à partir desquels le discours de l’œuvre se structure ensuite de manière organique. Le second a trait à la manière dont le silence prend son sens par rapport à l’œuvre entière en jouant sur la mémoire et la répétition variée qui sont au cœur de la conception du discours musical de toutes les œuvres jusqu’aux avant-gardes des années 1950. Abandonnant le plus souvent le principe de réexposition, celles-ci ont introduit les formes en panneaux indépendants, cessant ainsi de solliciter la mémoire de l’auditeur en cherchant à ne l’enivrer que de choses nouvelles.
Silences structurant le matériau de base
Le choix du matériau de base est une opération essentielle pour Beethoven qui privilégie toujours une conception organique de la composition. C’est dire qu’il envisage l’œuvre comme une totalité découlant d’un principe générateur. Le résultat s’avère en général d’autant plus remarquable que ce principe est plus simple. Immer simpler (toujours plus simple) est d’ailleurs une maxime qui guide le cheminement créateur beethovénien : pour le compositeur, la puissance expressive passe par la clarté d’expression qui impose ellemême une exigence de simplicité de conception, quelle que soit ensuite la complexité de réalisation. Ainsi les cahiers d’esquisse montrent la manière dont le matériau va en se simplifiant au fur et à mesure du travail de Beethoven, pour arriver parfois à des formules si évidentes apparemment, qu’elles semblent couler de source.
L’objectif d’organicité du matériau beethovénien, qui impose forte concision et caractère marqué, conduit le compositeur à penser l’écriture en termes de motifs, la longue phrase et notamment les fameuses carrures de huit mesures se construisant par exemple par l’enchaînement à lui-même du motif ou de ses répétitions variées. Dans ce cadre, le silence joue souvent un rôle très important. Nous en donnerons deux exemples, le début du Scherzo de la IXe Symphonie et le début de l’Allegro initial du 8e Quatuor opus 59 n° 2.
Scherzo de la IXe Symphonie opus 125
Le deuxième mouvement de la IXe Symphonie – appel à la lutte après l’expression de souffrance de l’Allegro initial qui se termine par une sorte de marche funèbre – est un scherzo qui oppose ses parties extrêmes (AA’) Molto vivace d’une extrême pugnacité à un trio (B) Presto souriant et quasi champêtre.
Les huit premières mesures du Molto vivace sont traversées par quatre mesures de silence qui suivent chacun des trois énoncés du motif générateur g des parties A et A’. Les deux premiers énoncés de g sont simples, le troisième est double selon l’enchaînement suivant :
g s g s g g s s
Le motif g au rythme acéré est fait de trois notes homonymes, la première étant séparée des deux suivantes par un saut d’octave descendant. Ses quatre énoncés déclinent l’arpège descendant de ré mineur (ré, la, fa, ré), tonalité du mouvement, disposition traditionnelle et même banale si le génie de Beethoven ne se manifestait pas en deux gestes spectaculaires :
-d’une part, la combinaison d’une disposition d’orchestration et d’une perturbation rythmique ;
-d’autre part, l’utilisation très efficace des silences.
Ex. 12 : IXe Symphonie, Scherzo, mes. 1-8
Le couple « g s » s’étant affirmé à deux reprises avec g aux cordes, on s’attend à ce qu’il en soit de même pour le troisième énoncé. Au lieu de cela, Beethoven le confie pour la note fa aux timbales, instrument à percussion parfaitement adapté à la nature rythmique de g et il enchaîne directement le quatrième (ré) joué par tout l’orchestre cette fois, hormis les timbales L’intervention des timbales seules, suivi de la masse orchestrales est d’un effet tellement saisissant que c’est cela que l’on retient de ce début.
Dans ce dispositif, le silence joue un rôle clef.
Élément séparateur, il est d’abord un espace réflexif qui permet d’isoler le motif générateur et de le prendre en compte comme tel. Après l’énoncé double, le troisième silence est un silence-résonance aux fonctions multiples : il clôt le processus d’exposition du thème, il accueille la résonance de l’accord cuivré de la mesure 6 et permet de prendre en compte le rôle des timbales, ce qui d’une certaine manière prépare à comprendre l’importance de cet instrument dans tout ce scherzo – où elles font presque figure d’instrument soliste – et cela de pair avec les silences très présents en particulier à la fin des parties A et A’.
On voit donc ici que le silence joue un rôle structurant non seulement pour le matériau de base mais même pour l’ensemble du scherzo.
Allegro du Quatuor opus 59 n° 2, début
Ce début de quatuor commence par deux accords v forte, puissants, à la fois massifs et incisifs, suivis d’un long silence et dont la ligne supérieure au violon 1 décrit une quinte ascendant (mi-si). En deux mesures Beethoven a posé le principe actif qui va régir tout le mouvement : l’intervalle générateur de quinte structure le matériau thématique et le geste « vectorisé » vers le haut constitue le pôle principal de l’opposition du linéaire et du circulaire au cœur du discours de cet allegro. Quant au silence s1 qui suit ce geste, il est à la fois un élément de ponctuation qui attire l’attention sur les deux accords qu’il suit et il est évidemment silence-suspens, puisqu’on reste en suspens sur ce 5e degré instable, et silence-tension puisqu’on est tendu vers ce qui va venir.
Il s’agit d’un motif circulaire c qui parcourt vers le bas puis vers le haut l’intervalle mi-si pour revenir finalement au mi de départ. Après le dynamisme volontaire et quasi conquérant des deux accords v, puis le silence intense et troublant de la mesure 2, le motif c semble émerger d’un abysse et fait figure d’énigme. Nouveau silence s2 d’une nature toute différente de s1 qui prolonge l’espace du questionnement implicite de c1 puis voici un nouvel énoncé de c2 de c haussé d’un demi-ton (Fa majeur au lieu de mi mineur), puis un nouveau silence s3 équivalent à s2 et qui en renforce le poids réflexif avant que le discours ne prenne encore (mesure 9) une nouvelle orientation à partir d’un élément transformé de ce matériau (c’) et commence à se lancer avec fièvre mais de manière résolue dans l’action.
Ex. 13 : Quatuor opus 59 n° 2, Allegro, mes. 1-10
On le voit, les huit premières mesures de ce mouvement sont d’une nature étrange, inhabituelle et même inédite. Elles introduisent une manière nouvelle de concevoir l’entrée en matière d’une œuvre : plutôt qu’un « produit fini », le déploiement continu et assuré d’un thème mélodico-rythmique, Beethoven semble nous livrer le secret de sa composition en action, avec des choix des remises en question, des sortes de coups de gomme même, comme s2 qui semble effacer c1. Les trois silences de ce début de quatuor ont en commun d’être suivi d’un changement de direction du discours, chaque fois de nature différente :
v s1 c1 s2 c2 s3
Une des forces et des originalités de ce passage c’est de donner, en particulier via les silences, une impression de liberté comme une improvisation ou un cahier d’esquisse et d’être en même temps puissamment pensé et structuré, puisque toute la suite découle de ces huit premières mesures. Une série de matériaux élémentaires bien isolés les uns des autres, donnés comme des objets inachevés, désassemblés seront les arguments sur lesquels sera effectué le travail du discours musical. Il s’agit là du premier exemple déjà très élaboré de pré-exposition de type « boîte à outils » ou « réservoir de motifs » qui trouvera son expression la plus achevée dans l’Ouverture de la Grande Fugue et dans la transition précédent la fugue de l’Opus 106.
Silences structurant le discours, cas de l’ellipse
Quelles que soient par ailleurs ses fonctions, le silence est toujours résonance du son qu’il précède et il se révèle un agent de réflexivité dans la mesure où il constitue un espace-temps permettant à la conscience de réécouter intérieurement ce qui vient de se produire. Le plus souvent, son influence s’applique à des données sonores immédiates.
Mais, penseur visionnaire de la forme, Beethoven montre parfois l’originalité de corréler le silence avec des événements anciens du discours. Pour ce faire, il pousse à leurs limites les fonctions de variation (thème suivi de différentes « réinterprétations du thème) et/ou de réexposition, celle-ci jouant un rôle essentiel dans toutes les formes classiques comme la sonate , le lied , le rondo .
Le traitement par Beethoven du silence en corrélation à la forme donne lieu à un foisonnement de dispositions remarquables qui consistent souvent à lui conférer un statut équivalent à certains fonctions narratives ou figures de style utilisées par exemple dans le roman, ainsi l’ellipse dont nous donnerons deux exemples le premier dans une forme variation en comparant le thème des 33 Variations « Diabelli » opus 120 et sa 13e variation et l’autre dans un exemple de forme sonate, le premier mouvement du Quatuor opus 127.
Silence d’approfondissement dans la 13e variation « Diabelli »
Les variations Diabelli consistent en 33 métamorphoses d’un thème de valse charmante mais assez anodine, voire banale. Dès la première variation Beethoven donne du sens, de la consistance, un poids de gravité à ce thème essentiellement léger. Mais c’est la 13e qui nous intéresse ici pour le rôle qu’y jouent les silences.
Dans cette variation, Beethoven occulte des parties importantes du thème qui au lieu d’avoir une traduction sonore – variante motivique – sont représentées par des silences. Cette disposition met l’auditeur en situation de les « remplir » dans son for intérieur que ce soit par le souvenir de bribes du thème ou des variations, voire par une construction imaginaire.
Cela est rendu possible parce que le principe des variations consiste à remplir le même cadre, donc grosso modo la même durée – en l’occurrence, deux séquences de huit et seize mesures et leurs reprises – avec des transformations, différentes pour chaque variation, des éléments constituant le thème.
Dans la variation 13, au lieu de motifs, il y a des silences qui se placent à la fois dans la résonance d’accords qui sont des images de fragments du thème et dans la résonance intérieure des éléments de ce thème.
C’est ce que montre l’exemple ci–dessous qui met en regard les mesures 1 à 8 du thème et les mesures 1 à 8 de la variation 13.
Ex. 14 : Variations « Diabelli », thème et variation 13, mes 1–8
Les silences occupent dans la variation 13 la même durée que certains motifs explicites du thème : le tempo, Vivace, est le même pour les deux séquences. Ils sont des espaces où interfèrent, d’une part, la résonance des sons propres à la variation – forte et denses, images de l’anacrouse linéaire du thème, piano et linéaires, image des batteries de trois sons du thème –, d’autre part, la trace mémorielle du thème et ses douze premières variations que l’aventure de l’œuvre, en se déroulant, a laissé s’incruster dans la mémoire.
Ces silences vides par définition de toute sonorité explicite sont en fait chargés de signification musicale. Le vide créé, là où la structure thématique faisait attendre une image sonore, se définit comme une résonance en creux de l’ossature harmonique du thème dont certains fragments sont occultés, élidés.
Outre leur fonction dans l’économie du discours, ces silences donnent un grand poids expressif et de la profondeur à cette image du thème de valse.
Silence transcendance dans le premier mouvement du 12e Quatuor opus 127
Le premier mouvement du Quatuor opus 127 met en œuvre une structure originale de forme hiérarchisée, mêlant la traditionnelle forme sonate à une sorte de forme variation.
Le principe de variation porte sur une section lente, Maestoso. Présentée comme introduction – c’est le portique majestueux qui ouvre sur l’univers des cinq derniers quatuors –, elle réapparaît à deux reprises toujours plus haut dans l’espace – à la fin de l’exposition et au milieu du développement. Annoncé au début de la coda à un niveau plus haut encore, elle se trouve élidé ; cette quatrième occurrence, remplacée par un silence, silence-ellipse, ouvrant à une coda où les éléments thématiques sont transfigurés.
Ici, contrairement aux silences de la 13e variation Diabelli pour lequel une large marge d’interprétation est laissée à l’auditeur, celui qui ouvre la coda du premier mouvement de l’Opus 127 est puissamment déterminé par la manière dont Beethoven le met en scène dans la perspective des trois occurrences du Maestoso.
Après le premier Maestoso (introduction) exposé dans les graves du violon (à partir du mib3), le deuxième qui précède le développement, est placé à la dixième supérieure (une octave et une tierce plus haut), le violon 1 commençant par un sol4. Cette occurrence suit un épisode de préparation avec des procédures d’approches nettement marquées. Placée au cœur du développement – et non pas comme on aurait pu s’y attendre avant la réexposition –, la troisième occurrence se place encore une quarte au-dessus (violon 1 commençant sur do5). Peu avant la coda (mes. 231), Beethoven reprend de manière strictement homologue, les procédures d’approche du deuxième Maestoso et on s’attend à l’avènement d’une quatrième occurrence placée encore plus haut (les dispositions harmoniques font attendre un sol5). Au lieu de cela un silence d’une mesure (mes. 239). Après lui, le discours prend une tout autre tournure. Transfiguré, un élément a du premier thème de l’Allegro, s’inscrit alors dans une procédure litanique tandis que se déploie de plus en plus haut, une ligne paisible en valeurs longues conjointes (blanches pointées legato), comme un cantus firmus. Circulant à toutes les voix et entourant les répétitions variées du motif, elle culmine dans le chant suraigu du violon 1, donnant une image de la transcendance.
Ex. 15 : 12e Quatuor opus 127, premier mouvement, mes. 231-250, ellipse du 4e Maestoso, procédure d’approche et début de la coda
[2 systèmes]
Étant donné la différence de ton entre les trois premières parties du mouvement (lyrisme majestueux, effusif, mélancolique avec des bouffées passionnées voire violentes) et la coda, le silence-ellipse de la mesure 239 semble exercer une fonction de transfiguration. Ce mouvement se termine d’ailleurs d’une manière tout à fait inhabituelle pour un premier mouvement de quatuor. Ni triomphal, ni culminatif dans son expression, ni synthétique ni liquidatif dans ses fonctions discursives, l’apaisante et rayonnante coda, qui mêle avec une infinie douceur les répétitions litaniques d’un motif thématique et le déploiement d’un cantus firmus – il n’est mis au jour que dans cette section du mouvement –, exprime une forme de sagesse proprement beethovénienne faite de gravité et de générosité, de joie profonde et de tendresse.
Conclusion
Beethoven n’a assurément pas inventé le silence en musique ; bien d’autres compositeurs l’ont utilisé avant lui comme élément de ponctuation ou moyen expressif. Mais, avec Beethoven, l’utilisation du silence se développe, au point de constituer un élément particulièrement significatif de son vocabulaire et un outil puissant de sa poétique musicale.
Plutôt qu’accompagnement prolongé de la fonction de ponctuation ou agent de respiration de la phrase – ce qu’il peut être également –, le silence beethovénien se montre souvent élément de rupture.
Parfois alors, il coupe net dans l’espace horizontal comme le feraient des ciseaux qui tailleraient au hasard, en un point de son déroulement, le texte de la partition, interrompant par exemple un processus engagé pour faire place à un élément nouveau. Parfois il semble effacer, comme le ferait une gomme, un bloc de l’espace horizontal, une partie d’un texte déjà attesté comme tel et rend ainsi adjacents deux segments initialement éloignés.
Mais le silence beethovénien se distingue surtout, nous l’avons vu, par son pouvoir expressif et par sa signification en rapport avec la conduite du discours à grande échelle.
Ainsi le silence-ellipse se réfère à un état antérieur du texte musical dont il restitue l’exacte chronologie en en éliminant certains temps forts (Variations Diabelli) ou dont il modifie de manière inattendue mais heurt le devenir (Quatuor opus 127) pour revenir sur les exemples que nous avons présentés.
Ici comme dans d’autres exemples de ce type, le silence agit comme signe de l’omission syntaxique d’événements que l’esprit de l’auditeur est amené à combler de manière plus ou moins spontanée. Il se substitue à l’événement attendu et éludé, soit comme transition vers un événement nouveau ou inattendu, soit comme événement en creux, espace vide d’une temporalité inaltérée.
Qu’il prolonge une question, qu’il souligne ou détermine une rupture, qu’il constitue une ellipse, le silence sollicite la réaction de l’auditeur. Il est peut-être le lieu privilégié de la communication biunivoque entre le compositeur et l’auditeur, l’espace musical par excellence où une procédure d’appel du compositeur engendre une réponse implicite mais nécessaire de l’auditeur qui cesse soudain d’être submergé par le discours de l’autre.
Dans l’espace de tous ces silences, particulièrement des plus longs d’entre eux, l’esprit de l’auditeur est libre de se mouvoir, d’apporter sa réponse à la sollicitation qui l’a mis en branle.
Si l’idéal classique du discours musical se définit dans la continuité de la matière ou de la pâte sonore, les silences qui peuvent s’y agréger apparaissent comme des corps étrangers, des parasites, des bruits et, comme tels, ils sont un puissant agent mobilisateur d’attention.
Ils tiennent en éveil ou réveillent un auditeur qu’un processus ronronnant aux rouages trop simples et au devenir trop prévisible pourrait démobiliser, et, à ce titre, ils font partie de toute la panoplie des moyens que Beethoven utilise pour rompre toute habitude d’écoute que le discours aurait pu contribuer à établir s’il n’était que linéarité ou continuité. Il permet ainsi de modifier soudain un éclairage, une atmosphère, un paysage musical, en créant et orientant la situation d’attente d’un événement qui, s’il est prévisible, pourra se produire, se transformer ou bien se dérober.