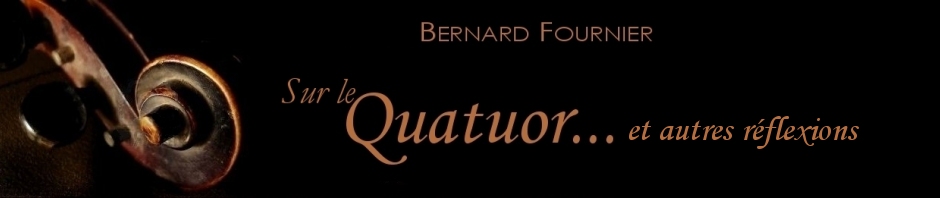Beethoven et la question du génie
Déterminations culturelles et influx personnel
À propos de Beethoven et la construction du génie de Tia DeNora (Fayard, 1998)
Depuis leur création, les chefs-d’œuvre de Beethoven n’ont cessé, comme ceux de quelques autres grands compositeurs, de solliciter l’analyse musicale dévoilant sans cesse de nouveaux visages d’eux-mêmes à travers l’évolution des grilles de lecture ; mais, comme l’écrit Boucourechliev, l’œuvre de Beethoven possède aussi ce « don de migration perpétuelle » (Boucourechliev) par lequel elle interpelle les musiciens de chaque époque ; elle n’a rien perdu aujourd’hui de sa force subversive et reste susceptible de nous remettre en question à travers notre propre écoute.
Beethoven en effet se distingue aussi bien des musiciens avant tout intéressés par l’écriture en tant que telle, musiciens de la technè, que des musiciens prioritairement préoccupés par l’expression, musiciens de l’ethos, il apparaît par excellence comme le musicien de l’epistémè, un musicien de la question en soi, la question posée à l’écriture par l’écriture et qui reste objet d’énigme. Mais écriture et expression restent fondamentales pour ce compositeur, celle-là comme le moyen, celle-ci comme la manière.
Au-delà même de l’œuvre et de la sphère des musicologues, le cas de Beethoven n’a cessé d’intéresser les esprits les plus divers ; commentateurs et chercheurs de tous horizons ont développé d’innombrables gloses sur le compositeur que ce soit pour interpréter les différents épisodes de sa vie tumultueuse et romanesque, étudier les différents aspects de sa personnalité complexe, que ce soit pour s’interroger sur la formation et l’évolution de son génie.
Désignant d’abord la nature propre de l’être, ses dispositions naturelles, le mot génie a commencé à être utilisé à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle (d’Alembert, Discours de réception à l’Académie française) mais surtout au début du XIXe siècle, notamment par Schopenhauer pour distinguer un homme qui porte la marque du génie, c’est-à-dire, un ensemble de qualités « élevées à leur plus haute expression » (Vincent d’Indy, Cours de composition musicale, p. 15) permettant de créer des œuvres « essentiellement originales » (ibid.) qui « paraissent extraordinaires ou surhumaines à ses semblables » (Robert).
C’est autour de Beethoven d’ailleurs, plus que d’aucune autre des grandes figures de la musique, que la
question du génie – ses déterminants, son évolution, ses manifestations – a été posée avec le plus de force et en déclenchant jusqu’à nos jours des controverses. Cette question est effet particulièrement intéressante à étudier chez ce musicien à la stature exceptionnelle où se conjuguent une grande œuvre et un destin hors du commun à un moment de l’histoire où se fait jour une nouvelle conception de l’artiste.
En effet, la carrière de Beethoven s’est déroulée à une époque où, le rôle de l’art et la notion de génie ayant été réévalués notamment par la réflexion philosophique, le pouvoir créateur de l’artiste a eu tendance à se substituer, dans l’imaginaire collectif, à la toute-puissance de Dieu. Chez Beethoven, pour qui le problème de la figure paternelle revêtait une importance cruciale, une telle image de l’artiste ne pouvait que trouver une intense résonance fantasmatique.
Le compositeur a ainsi contribué de manière décisive à forger une conception romantique du génie, comme héros des temps modernes, d’autant que son histoire personnelle – avec, comme le note judicieusement Barthes dans son article Musica Practica (L’Arc, n° 40, 1970), « un discours (fait rare pour un musicien), une légende (une bonne dizaine d’anecdotes), une iconographie, une race (celles de Titans de l’Art : Michel-Ange, Balzac) et un mal fatal (la surdité de celui qui créait pour le plaisir de nos oreilles) » – possède les qualités constitutives d’un mythe.
On peut donc comprendre pourquoi, plutôt que Bach ou Mozart pour ne citer que des compositeurs de stature comparable, c’est la figure de Beethoven qui a focalisé sur elle le plus grand nombre de réflexions et surtout de polémiques autour de la question du génie. Contrairement à ses deux prédécesseurs, et ce en partie pour des raisons historiques et psychologiques, Beethoven s’est engagé personnellement avec détermination dans l’émancipation de l’art et de la figure de l’artiste. Il fut un des premiers à défendre les spécificités de la musique par rapport aux autres arts et à prôner l’importance de l’art en général dans l’ensemble des activités humaines. On on a souvent signalé qu’il a été le premier musicien libre, mais il fut surtout le premier à revendiquer et à obtenir, en tant qu’artiste, une prééminence qui renversait la hiérarchie sociale traditionnelle.
Avec Beethoven, non seulement le génie apparaît, comme chez Bach et Mozart, dans la plénitude de sa fonction transcendantale, mais il acquiert une dimension prométhéenne : l’œuvre n’est pas chez lui un don de Dieu, elle est plutôt un rapt de l’homme. Et même si la création est toujours un combat, Beethoven semble s’y engager avec une énergie sans précédent ; mais surtout, il donne à ce combat une véritable force symbolique : il compose, disons, « après la chute », à un moment, où ayant perdu son caractère édénique, l’art, en tant qu’expression de la sensibilité, commence à être considéré non plus comme un don de Dieu, mais comme le propre de l’homme ; il apparaît alors comme le moyen le plus radical d’affirmer sa subjectivité, mais de l’affirmer aux yeux du monde, c’est-à-dire, dans le cas de Beethoven, selon une perspective universalisante.
Si, comme bien d’autres, Beethoven s’est battu avec lui-même pour créer, son œuvre – et cela est nouveau – porte parfois elle-même les marques de ce combat à travers la dynamique spécifique de son écriture dialogique et les oppositions sans précédent, voire les séismes, qu’elle met en scène. C’est ainsi que dans Musique et verbe, Furtwängler écrit que Beethoven est le premier compositeur à avoir introduit dans la musique « l’équivalent de ce qu’est une catastrophe naturelle ». Qui plus est, en amont même de l’œuvre, le processus de création – tel que le laissent percevoir les nombreuses esquisses préparatoires – témoigne lui aussi du passage à une nouvelle conception de l’art. L’artiste n’est plus cet « aimé de dieu » qui transcrit le fruit de son inspiration : créant de toutes pièces son matériau en une longue élaboration, il est un homme qui travaille, déployant un effort manifeste pour atteindre le beau. Cette conception à travers laquelle l’art s’émancipe de la caution divine va conduire en fait à un nouveau type de sacralisation amenant à réévaluer la fonction de l’artiste et à lui donner la première place dans l’imaginaire social.
Une conception prométhéenne de l’artiste
Après avoir l’un et l’autre passé une part importante de leur carrière dans la dépendance d’employeurs princiers ou ecclésiastiques, Haydn et surtout Mozart avaient déjà fini par se libérer de la tutelle nécessairement contraignante et souvent même humiliante de leurs maîtres. Dans ses fonctions de Kapellmeister, Haydn qui portait livrée, devait composer la musique que le prince Estherazy lui demandait et il ne pouvait écrire pour qui que ce soit d’autre sans autorisation. À la cours de l’archevêque Colloredo à Salzbourg, Mozart occupait un rang supérieur aux cuisiniers de table mais inférieur aux valets. Tout en continuant à servir la famille Esterhazy, Haydn se lança cependant dans une carrière publique dans les années 1790 avec notamment des concerts à Londres puis des activités viennoises avec le soutien du baron Van Swieten (1733-1803)) ; quant à Mozart, s’il vécut finalement en musicien totalement indépendant pendant ses dix dernières années, il ne réussit pas à assurer sa subsistance avec les seules ressources de son art et il mourut dans la misère.
Nouveau paradoxe chez cet artiste désireux de rester pleinement maître de son destin, Beethoven, marqué notamment par l’image de son grand-père – Ludwig van Beethoven (1712-1773), porteur du même prénom que lui –, maître de chapelle à la cour électorale de Bonn, rêva longtemps d’exercer une charge de Kapellmeister qu’il n’obtint jamais. En revanche, il assuma avec succès son statut de musicien libre : à partir de son arrivée à Vienne (1792), il ne fut jamais directement au service de quiconque tout en bénéficiant néanmoins de commandes ou de pensions substantielles elles-mêmes versées, sur l’ensemble de sa carrière, par une quinzaine de familles de l’aristocratie viennoise. De fait, bien plus que ses deux aînés, celui-ci encore relativement soumis (Haydn) ou celui-là finalement vaincu par l’ordre social (Mozart), c’est Beethoven qui, notamment, à travers une véritable inversion du rapport de force avec ses mécènes – il amène certains aristocrates viennois craignant de le voir quitter Vienne à passer sous les fourches caudines de ses exigences -, contribuera avec la plus grande efficacité à s’émanciper socialement en tant qu’artiste et obtiendra, comme tel, le respect des puissants. Malgré ses propos parfois subversifs, iI fut considéré comme « intouchable » par la police de Metternich sous couvert d’un : « On n’arrête pas Ludwig van Beethoven ». On mesure la distance parcourue depuis le coup de pied de Colloredo à Mozart.
Car ce qui guide avant tout Beethoven en tant qu’artiste et le distingue de ses prédécesseurs, c’est la conviction maintes fois formulée d’avoir à communiquer à travers sa musique un message personnel ne souffrant aucun compromis, ce qui suppose une inhabituelle liberté tant vis-à-vis des institutions et de la tradition que du jugement du public et de la critique : par delà les incompréhensions de ses contemporains, le compositeur s’en est d’ailleurs souvent remis au jugement de la postérité, attitude typique, notons-le, des avant-gardes du XXe siècle.
Grâce en partie à sa personnalité « indomptable » – pour reprendre un jugement de Haydn – et à un contexte social plus favorable que celui de ses prédécesseurs (l’influence, même à Vienne, de certains principes de la Révolution française), Beethoven pourra ainsi imposer ce que l’on peut considérer comme l’image de l’artiste moderne.
D’où la manière dont il mène ses négociations tant avec ses commanditaires que ses éditeurs, jouant de toutes sortes de ressorts comme la théâtralisation ou la médiatisation ; d’où son attitude parfois intraitable avec ses interprètes (« Croyez-vous que je pense à vos misérables cordes quand l’esprit me parle ? », lance-t-il à Schuppanzigh à propos de l’Opus 59 n° 1) ; d’où son exigence vis-à-vis du public à qui il ne s’agit pas de chercher à plaire aujourd’hui (« Ce n’est pas pour vous, c’est pour les temps à venir » dit-il au violoniste Félix Radicati, désappointé par l’audition de l’Opus 59 n° 1 ; d’où son affranchissement des règles : « Il n’y a pas de règle qu’on ne peut blesser à cause de « Schöner » (plus beau) ».
D’où également, l’affirmation de la supériorité de l’artiste sur l’aristocrate, ce qu’il traduira de manière aussi lapidaire que brutale en 1806 dans un billet adressé, après une altercation, au prince Lichnowsky, un de ses mécènes, dont, geste symbolique, il brisera ensuite le buste : « Prince, ce que vous êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis par moi. Des princes il y en a et il y en aura encore des milliers. Il n’y a qu’un Beethoven » (cité par Jean et Brigitte Massin, Ludwig van Beethoven, Fayard, 1967, p. 156).
.
Au-delà de l’anecdote, avec cette émancipation de l’artiste telle que la défend Beethoven, c’est un véritablement changement perspective qui s’opère, introduisant en fait une nouvelle hiérarchie entre les hommes – le génie, le « grand individu » se distinguant de l’homme ordinaire, fut-il un prince. D’ailleurs, pour lui, ce principe de hiérarchisation devait toucher aussi tous les domaines de l’art à commencer par les œuvres elles-mêmes : le compositeur différenciera en effet soigneusement dans son propre catalogue les œuvres véritables, dignes de recevoir un numéro d’opus, et les autres (WoO, Werk ohne Opuszahl, œuvre sans numéro d’opus) dont certaines sont de puissants chef-d’œuvres, comme la Cantate sur la mort de Joseph II (WO 87) ou les 32 Variations pour piano en ut mineur (WoO 80). Il juge même parfois certains de ses opus avec sévérité, voire avec mépris : Es ist Dreck (c’est de la merde), s’exclama-t-il, par exemple un jour à propos du Quatuor opus 18 n° 4. En dehors des propos qu’il a pu tenir ou de son attitude exigeante vis-à-vis de ce qu’il composait, il manifesta une tendance de plus en plus nette – l’histoire de ses quatuors le montre particulièrement bien – à la personnalisation radicale de chacune de ses grandes œuvres, contribuant aussi à faire émerger une nouvelle conception du chef-d’œuvre, tel qu’il fut envisagé à partir du début du XIXe siècle.
À travers la hiérarchisation qu’elle sous-tendait, l’attitude prométhéenne de Beethoven s’est accompagnée de positions manifestement élitistes. Épris de grandeur, il était fasciné non pas par les puissants qu’il pouvait mépriser, mais par les grands individus qui devaient selon lui jouer un rôle important dans une société qu’il craignait de voir soumise à « la prépondérance du petit » selon une formule du Yi-King. Si c’est bien pour le donner aux hommes qu’il « dérobait » symboliquement l’art aux dieux, le compositeur avait en même temps le sentiment aigu d’appartenir à une catégorie privilégiée d’hommes, celle des vrais artistes : « Je sais que je suis un véritable artiste » aimait-il à dire.
Figure emblématique de l’artiste de génie, se présentant lui-même parfois orgueilleusement comme appartenant, grâce à ses dons et son travail créateur, à une classe supérieure, il était logique que ce compositeur, plus qu’aucun autre, concentrât sur lui les attaques non pas tant de ceux qui sous-estiment l’importance des qualités innées – nous avons vu, dans le cas de Beethoven, quelle est l’importance de l’acquit dans la période de Bonn –, mais de ceux qui réfutent le caractère transcendantal du génie. C’est dans cette perspective que s’inscrit
la sociologue Tia DeNora dont nous critiquons ci-dessous les thèses.
Le génie et la « construction » sociale
Faisant l’impasse totale sur la période de Bonn, vingt-deux ans pendant lesquelles s’est pourtant forgée la personnalité de Beethoven, celle de l’homme et du musicien, la sociologue minimise à l’extrême le rôle personnel du compositeur et la qualité de son œuvre dans la construction de sa propre notoriété. Elle en fait porter l’essentiel du poids sur l’environnement socio-culturel de Beethoven dans sa première décennie viennoise. C’est ainsi qu’elle accorde la plus grande importance à l’action de ses mécènes dans la période 1792-1803 : commanditaires et surtout promoteurs de son œuvre, ce sont eux qui, en s’appuyant sur les qualités musicales du pianiste virtuose et du jeune compositeur rhénan bien doué, auraient su faire reconnaître cette œuvre – une œuvre envisagée dans le livre indépendamment de ses qualités particulières, et considérée comme une parmi d’autres, ni plus, ni moins – l’imposant, par des moyens équivalents à notre moderne publicité, comme une nouvelle norme de qualité, celle de la musique sérieuse, celle à partir de laquelle devait se constituer le jugement de goût au XIXe siècle.
À en croire Tia DeNora, si le cénacle des amis de Raimund Wetzlar qui soutenait concurremment le pianiste et compositeur Joseph Wölffl (1772-1812) avait été plus puissant et doté de meilleures outils de « relations publiques » que celui de Lichnowsky, protecteur de Beethoven, c’est la musique de Wöffl que nous serions censés admirer aujourd’hui. Et la sociologue de poser cette question : « Comment par exemple convaincre les milieux musicologiques actuels que la musique de Wöffl pourrait être « meilleure » que celle de Beethoven ? Ce point de vue fut pourtant défendu par certains contemporains ».
Cette question, qui sonne comme un regret laisse, aussi transparaître chez la sociologue une sorte de dépit devant la notoriété de Beethoven, comme si elle constituait une injustice de l’histoire vis-à-vis de tous les musiciens obscurs mais talentueux qui, contrairement à lui, n’ont pas eu la chance de voir leur talent couronné par l’auréole du génie ; car même si, elle n’est rien de plus, selon l’auteur, qu’une construction sociale, elle est bien la marque suprême du succès.
En fait, ce n’est pas seulement la légitimité de la position de Beethoven dans la panthéon des grands musiciens que Tia DeNora tente d’attaquer ou d’ébranler, mais, à travers le statut du compositeur, c’est la notion même de génie qu’elle entend mettre en cause : tous les artistes dont nous admirons les œuvres sont ainsi indirectement visés par une conception qui tend à assimiler l’œuvre d’art à un simple produit et subordonne son succès à des considérations de type commercial, indépendamment de toute référence à une valeur intrinsèque.
À travers une série de démonstrations aux apparences scientifiques (références précises à une documentation, tableaux comparatifs), mais d’une rigueur pour le moins contestable – de nombreuses et importantes données du problème ne sont pas prises en compte –, et une formulation suggestive jouant sur le sous-entendu, Tia DeNora anesthésie le sens critique du lecteur qui pourra se demander en refermant son livre s’il ne devrait pas préférer Pleyel à Haydn, Salieri à Mozart, Dussek à Beethoven, et lire Népomucène Lemercier plutôt que Hugo et Paul-Louis Courier plutôt que Stendhal.
Le caractère à la fois partiel – les aspects les plus importants soulevés par la question du génie sont laissés dans l’ombre – et partial – la sociologue rêve de faire tomber l’artiste de son piédestal – de la thèse de Tia DeNora appelle en fait une discussion qui nous permettra d’ailleurs de réfléchir aussi bien à certains aspects du développement particulier de Beethoven qu’à la phénoménologie du génie en général.
Le génie, la construction personnelle et la mode
En passant sous silence toute la période de Bonn et notamment les aspects psychologiques particulièrement originaux qui conditionnent alors le développement de Beethoven, Tia DeNora évacue une des raisons majeures pour lesquelles le jeune compositeur a pu s’imposer à l’aristocratie viennoise et lui imposer non seulement sa façon d’être hors norme dans les salons aristocratiques qu’il fréquenta mais sa musique d’emblée étrange, par certains de ses aspects, si on la compare à celle de ses prédécesseurs ou contemporains.
Le génie et les aristocrates
Contrairement à la sociologue pour qui la carrière de Beethoven dans les années 1792-1803 s’est développée dans une « relation vertueusement circulaire » entre le compositeur et ses mécènes, nous pensons que Beethoven est l’exemple typique d’un artiste qui a su faire valoir, de manière particulièrement univoque, ses conceptions individuelles avec la plus grande indépendance, aussi bien vis-à-vis de ses maîtres auprès de qui il espérait pourtant fondamentalement apprendre (voir ses relations houleuses avec Haydn), que de la tradition (même si il contribua aussi à la porter et à la prolonger) ou des mécènes qui le soutenaient et avec lesquels il prenait les plus grandes libertés. Cela pouvait même aller même jusqu’à la grossièreté notamment lorsqu’il refusait de jouer ; ainsi, il ne cède pas aux prières de la comtesse Thun, une dame âgée, « à genoux devant lui qui était assis sur le sofa » (rapporté par Maynard Solomon, Beethoven, Fayard, 2003 p. 104).
Personne ne peut contester que c’était une chance artistique pour Beethoven que de s’être trouvé à Vienne à cette époque de l’histoire et d’avoir bénéficié de recommandations qui devaient favoriser sa carrière ; mais il ne faut inverser ni les rôles (ce ne sont pas les mécènes qui ont soufflé à Beethoven le secret de ses orientations esthétiques), ni l’ordre d’importance des facteurs : les qualités techniques et artistiques du musicien, les déterminations psychologiques de l’homme et les épreuves qu’il a subies nous paraissent – chacune prises isolément – bien plus importantes pour le succès à terme de Beethoven que ne le fut son seul environnement social.
La question de savoir qui était Beethoven en arrivant à Vienne – et tout donne à penser qu’il était déjà lui-même, musicalement et humainement – ne préoccupe pas Tia DeNora. Elle fait comme si son génie s’était construit à partir de 1792 ex nihilo grâce à la baguette magique de quelques aristocrates. Ainsi, ne tire-t-elle aucune conséquence d’une appréciation pourtant extrêmement précoce de Haydn qui considère, dès 1793, que « Beethoven est appelé à devenir un des premiers compositeurs européens ». À cette époque, Beethoven n’est l’élève de Haydn que depuis quelques mois ; le jugement de Haydn se fonde donc essentiellement sur les dons qu’il détecte chez le jeune compositeur ainsi que sur la possible lecture de certaines partitions conçues et/ou écrites à Bonn, qui reflètent elles-mêmes les qualités musicales de Beethoven avant toute prise en main supposée par ses mécènes, qualités qui le distinguent déjà des autres jeunes compositeurs gravitant dans la mouvance viennoise.
Le génie et la ville
Beethoven ne se plaisait pas à Vienne et cependant, malgré ses désirs ou tentatives, il n’a jamais réussi à quitter cette ville après y être arrivé à l’âge de 22 ans. Il y restera essentiellement pour sa carrière, qui pourtant se heurta à de nombreux obstacles et ce au cours de chacune des périodes de sa vie, même pendant cette décennie si favorable que pointe Tia DeNora et où, notamment, il dut combattre de nombreux ennemis qui le haïssaient et le jalousaient. À la fin de sa vie, Beethoven rêvait d’aller à Londres où il était réclamé, Londres cette ville où Haydn avait lui-même connu ses plus brillants succès, au moment où il était encore le professeur de Beethoven.
Si nous évoquons Londres, c’est que Tia DeNora laisse entendre que si Beethoven avait vécu dans la capitale anglaise, le compositeur, placé alors dans un contexte moins favorable et, en particulier, ne bénéficiant pas alors du précieux soutien de mécènes efficaces, n’aurait été qu’un autre Dussek – le compositeur y vécut de 1789 à 1799 – tout aussi obscur que son collègue tchèque.
Or d’un côté, il faut rappeler que l’œuvre de Dussek fut rien moins qu’obscure et le compositeur fut même très populaire de son vivant avec plusieurs éditions de ces œuvres – jusqu’à trois pour les plus importantes d’entre elles chez Breitkopf et Härtel ; ce n’est qu’après sa mort qu’il tomba dans l’oubli malgré les qualités techniques de son écriture et ses innovations (modulations éloignées, chromatisme) annonçant le romantisme. C’est sans doute qu’il lui manquait ce quelque chose de mystérieux en rapport avec le génie, qui, lui, ne manquait pas à Beethoven.
D’un autre côté, doit-on passer sous silence qu’à partir de 1820, les faveurs du public viennois se détournèrent de Beethoven pour se porter sur Rossini ; le compositeur devint alors sinon obscur – son nom resta connu –, du moins démodé, on ne le joua plus. Lorsqu’il lance une souscription pour la Missa solemnis, les rares soutiens qu’il reçoit viennent de l’étranger, la France et la Suède en particulier. Beethoven s’en plaint d’ailleurs au compositeur Ferdinand Hiller (1811-1885) en fustigeant « le dilettantisme qui pourrit tout [à Vienne] ». Plus tard il attaquera plus violemment encore le viennois qui « chante et racle de la musique insignifiante ou en fabrique lui-même […] Il n’a plus le sens de la vraie musique ! Oui, oui, viennois, c’est comme ça ! Rossini et compagnie voilà vos héros …De moi vous ne voulez plus rien… Rossini, Rossini über alles » (Propos rapportés par Johann-Andreas Stumpff après une visite à Beethoven en 1824).
Ainsi, ce que les mécènes viennois de Beethoven avaient fait dans les années 1800, Vienne l’a défait dans les années 1820, mais Beethoven est resté fidèle à sa démarche artistique. Dans cette troisième décennie du siècle, Rossini incarne quant à lui une tendance qui traduit avant tout le souci de plaire au public de l’époque. Étrangère à toute préoccupation métaphysique, sa musique, aussi bien faite et séduisante qu’elle soit, s’inscrit essentiellement dans l’esthétique du divertissement. Même le Stabat mater comporte ces « fugues si gentilles, si aimables, si délicates, si ravissantes » que fustigera, certes un peu injustement, Wagner mais dont le caractère s’accorde bien avec la conception opératique de Rossini. Son œuvre canalise en fait les aspirations de la mode tout en la constituant, ainsi que l’avait fait vingt ans plus tôt la musique de Beethoven, mais en suivant une direction exactement inverse.
Nous ne pouvons pas citer les nombreux exemples montrant la désaffection du public viennois vis-à-vis de celui qui était alors souvent considéré comme un musicien dépassé et un original, cependant elle conduit à penser que la construction sociologique de la notoriété revêt un caractère éminemment provisoire et que seul le temps – mais sur une période suffisamment longue pour lisser les effets de mode – et l’histoire permettent de prendre la mesure la plus objective du génie.
Le génie et le temps
Et c’est là une autre critique que l’on peut faire au livre de Tia DeNora qui laisse de côté cette dimension temporelle ou du moins n’analyse pas les effets sur la perception et le goût. D’un côté, elle considère l’émergence de la notoriété de Beethoven comme la construction d’une mode nouvelle dans laquelle le compositeur serait censé s’être inscrit tout en en profitant et de l’autre elle admet sans autre forme de procès le principe de pérennisation de cette mode, ce qui à la fois se révèle antinomique (toute mode passe) et se trouve contredit, nous l’avons vu, du vivant même de Beethoven.
Qui plus est, les jugements sur l’œuvre du compositeur ont beaucoup évolué : au cours du XIXe siècle,
on s’est intéressé essentiellement aux productions de la « deuxième manière » tout en considérant celles de la « première » comme parfaitement classiques, cela à la différence des contemporains de Beethoven qui les trouvaient étranges et, partant, étrangères au style en vigueur. À cette époque (1830-1870), les œuvres de la dernière période, appréciées seulement par un tout petit cercle de spécialistes (la plupart des grands compositeurs, à l’exception notable de Chopin) ont été soit ignorées, soit souvent même rejetées par la majorité du public et de la critique, comme en témoigne en France en 1868 encore, la position de Félix Clément dans son ouvrage Les musiciens célèbres : pour le critique, par ailleurs admirateur de Beethoven, les dernières œuvres « et surtout les derniers quatuors sont apocalyptiques. Non qu’il s’y rencontre encore, çà et là, d’éclatantes beautés et en assez grand nombre pour témoigner que c’est un soleil qui se couche, mais dans l’ensemble, la lumière fait défaut ; ce sont des créations puissantes où manque le fiat lux. […]. Il y a des élans magnifiques, suivis de développements pleins d’étrangeté, d’incohérence et de sauvagerie. […] L’ensemble m’en a paru d’une conception plus bizarre que belle et certains passages seraient réputés intolérables à cause de leur dureté si le nom de Beethoven ne rendait cet aveu pénible à tout musicien ».
Tout cela montre, d’une part, combien la notoriété est une notion fluctuante au moins du vivant d’un artiste et dans les années suivant sa mort et, d’autre part, combien il est spécieux d’envisager cette notion indépendamment de l’œuvre qui contribue largement à la légitimer. L’exercice entrepris par Tia DeNora aurait cependant pu se montrer plus convaincant pour éclairer la construction sociologique du génie si la sociologue avait choisi un compositeur dont l’œuvre, répondant à des paramètres rapidement stabilisés, avait présenté un visage relativement homogène et une progression linéaire. C’est un peu le cas de Mozart, ce n’est pas du tout celui de Beethoven dont, outre sa grande diversité, l’œuvre est inhabituellement hétérogène en particulier avec ses trois « manières » correspondant à trois périodes stylistiques et même à l’intérieur de chacun d’elles
Certes Tia DeNora relève bien l’« étrangeté » de l’œuvre de Beethoven, caractéristique qui ressort de tous les témoignages, mais elle n’en tire aucune conséquence, se contentant d’assimiler la contribution beethovénienne à l’émergence de ce qu’elle appelle le style sérieux – comme si c’était le style sérieux qui semblait étrange et non pas les ruptures, les événements imprévisibles du discours – qui aurait été imposé comme norme, grâce à l’action des mécènes. À l’arrivée à Vienne du jeune compositeur, ils l’auraient ainsi incité à cultiver le « style sérieux » ; misant sur un nouvel élitisme de type artistique, ils auraient espéré faire des œuvres de leur protégé le nouvel étendard de leur classe menacée mais encore dominante.
Mais, sérieuse, la musique de Haydn ne l’était-elle pas déjà ou celle de Mozart, sans parler de celle de Bach ou de Haendel ? S’il y avait quelque chose de nouveau qui permît de légitimer une telle campagne promotionnelle, c’était bien dans la musique elle-même, celle des premières œuvres datant de Bonn ou des tout débuts viennois. Si donc prescriptions ou incitations il y eut, elle n’influèrent sur Beethoven que dans le sens de sa propre conception.
Une fois encore, on voit que la sociologue ne prend pas en compte la dimension historique, ni en amont, ni en aval de la période qu’elle a choisi, ce qui invalide en partie les démonstrations proposées. C’est ainsi qu’évacuant les sujétions historiques qui affectent l’évaluation de l’œuvre d’art, elle ne fait pas de distinction entre le niveau de jugement des contemporains majoritairement résistant au changement – d’où le goût qu’ils pouvaient avoir pour la musique de Wölffl – et eux-mêmes conditionnés par des luttes d’influence les conduisant à prendre position dans un sens ou un autre – et le jugement des commentateurs plus tardifs, celui de la postérité donc qui, contrairement à ce qu’elle sous-entend, est moins entaché de partialité dans la mesure où les intérêts personnels ne sont pas directement en jeu.
Plus la distance temporelle qui nous sépare d’une œuvre d’art s’accroît – du moins jusqu’à une certaine durée –, plus se réalise ce que l’on pourrait appeler une pondération statistique de son évaluation esthétique ; l’histoire transcende les modes successives et les jugements individuels que, finalement, elle réconcilie en un large consensus autour des chefs-d’œuvre que d’une certaine manière elle authentifie.
Quelle que soit la manière dont l’histoire les révèle – dès le moment de leur création (ce fut généralement le cas des premières œuvres de Beethoven) ou après une période plus ou moins longue de gestation (ce fut le cas de ses dernières œuvres et notamment des derniers quatuors) –, les chefs-d’œuvre sont appelés à s’imposer à la communauté humaine dans le temps et ils le font avec une véritable force d’évidence, même s’ils gardent un caractère irréductiblement énigmatique, la qualité inépuisable de leur contenu justifiant des écoutes répétées qui permettent chaque fois d’entrevoir un horizon esthétique plus large et laissent découvrir de nouveaux gisements de sens.
Il est aussi naïf de croire, comme Tia DeNora, au chef-d’œuvre injustement tombé dans les oubliettes de l’histoire et de défendre ainsi Wölffl ou Dussek contre Beethoven, que de fantasmer sur les chefs-d’œuvre inconnus, produits à l’insu de l’histoire ; ils sont comme le bruit de ces arbres qui tombent dans la forêt sans que personne ne le sache, un bruit qui n’existe pas, comme nous le dit Heidegger dans un de ses aphorismes.
Une production artistique ne peut atteindre le statut de chef-d’œuvre que si elle est susceptible d’abord de se faire connaître – ce peut-être grâce aux efforts de l’artiste lui-même ou de ceux qui le soutiennent – puis de se faire reconnaître : outre le compositeur, et plus que les promoteurs de l’art contingents d’une époque, ce sont d’un côté les experts (éditeurs, critiques, compositeurs, interprètes) et de l’autre le public, dont les points de vue respectifs, pondérés par le temps, s’équilibrent, qui créent la dynamique socio-temporelle où l’œuvre puise la force de se communiquer au monde.
Le génie et l’homme
L’existence, dans l’immense production d’œuvres musicales, d’un nombre limité de chefs-d’œuvre produits par quelques très grands musiciens dans l’abondante cohorte des compositeurs, et reconnus comme tels par l’histoire, nous conduit à croire à la valeur d’exception et au caractère transcendantal du génie, un statut combinant de la manière la plus efficace pour sa sphère d’influence et son domaine d’application, qualités innées et qualités acquises. Reconnaître un tel statut à certains artistes, c’est une manière d’affirmer sa foi en la communauté humaine, aussi bien dans son aptitude à distinguer et reconnaître en son sein ceux qui sont susceptibles de se détacher en vertu de leurs qualités particulières, que dans la faculté de chacun à se dépasser à travers ses aspirations les plus élevées pour se plonger dans la contemplation des œuvres de génie – aux infinies perspectives d’écoute – et devenir ainsi soi-même cet « auditeur-artiste » que Nietzsche assigne comme objectif nécessaire à tout auditeur des chefs-d’œuvre. C’est en eux qu’il peut à se réaliser symboliquement, là où l’artiste de génie a lui-même réellement cristallisé les siennes.
Outre le plaisir esthétique qu’il peut trouver dans la fréquentation des chefs-d’œuvre, l’aptitude de chacun à être touché par le Beau et le Sublime, à admirer ce qu’il perçoit comme grand, au-delà de toute rationalisation, constitue pour lui, pour nous, un des dons les plus précieux de la vie, une aide à vivre, un rempart contre le désespoir : lorsque tout et tous nous abandonnent, il reste, au fond du fond, l’art des plus grands génies qui tous ont été confrontés à la souffrance, à la déréliction et à la mort et tous en ont exprimé, dans leurs œuvres, pour eux et pour nous, l’insondable mystère tout en éclairant d’une lumière un chemin dans ce labyrinthe.
D’une incomparable force émotionnelle, les chefs-d’œuvre induisent en nous un sentiment d’admiration et de gratitude pour ceux qui, en les composant, ont fait un tel don à l’humanité. Ce sentiment provoqué par les qualités inhérentes de l’œuvre de génie est encore aiguisé par la conscience de leur rareté, de leur singularité face à la myriade d’œuvres simplement séduisantes et bien faites, dont quelques écoutes seulement épuisent les perspectives. L’histoire du quatuor, par exemple, riche de plusieurs dizaines de milliers de partitions compte au plus deux ou trois cents chefs-d’œuvre, eux-mêmes dominés par le massif des seize quatuors de Beethoven.
Écouter l’honnête Quatuor opus 30 n° 1 composé en 1805 par Wölffl, le champion de Tia DeNora, ne fait que renforcer notre désir de réentendre un chef d’œuvre, par exemple le Quatuor opus 59 n° 1 composé en 1806 par Beethoven, où il y a toujours de nouveaux détails à découvrir et de nouvelles aventures auditives à vivre. Contingentes des modes, la plupart des œuvres ne possèdent pas cette dimension d’éternité et d’universalité qui permet à l’Opus 59 n° 1 comme à tous les véritables chefs-d’œuvre de résister au temps et de pouvoir apporter chaque fois une émotion renouvelée.
Le génie et l’innovation
Indépendamment du jugement que l’on peut porter sur l’idéologie réductrice qui sous-tend le livre de Tia DeNora – elle s’inscrit dans un courant post-moderne de nivellement des valeurs esthétiques –, la critique la plus importante que l’on peut faire à l’auteur concerne le principe même de la méthode employée qui escamote, nous l’avons plusieurs fois suggéré, une part essentielle de la question posée par la construction du génie, rien de moins que l’œuvre et ses qualités intrinsèques.
En effet, selon la thèse défendue, le chef-d’œuvre expression de l’artiste de génie, n’est considéré comme tel qu’en vertu d’un conditionnement culturel relevant essentiellement des stratégies sociales de groupes de pression ; ni les intentions et objectifs esthétiques de l’artiste ni la manière dont ils s’expriment dans la réalisation technique de l’œuvre ne sont pris en compte. Ainsi, le succès à long terme d’une œuvre ne dépendrait pas tant de ce qu’elle est que de la manière dont elle aurait été soutenue et promue. Envisagée comme produit, l’œuvre est ainsi jugée selon la logique capitaliste et les lois du marché : grosso modo, c’est le produit qui a bénéficié de la meilleure campagne de marketing qui l’emporte, quelles qu’en soient les qualités.
Or on peut penser, à l’inverse, que c’est avant tout grâce à ses qualités exceptionnelles d’artiste, notamment à la maîtrise technique de son domaine, et à son pouvoir innovant qu’un musicien est en mesure de pouvoir imposer son œuvre comme nouveau modèle culturel, un modèle qui, légitimé peu à peu par le public, la critique et les musiciens – peut-être, mais ce n’est pas toujours le cas, avec l’aide de groupes de pression – se légitime lui-même aux yeux de l’histoire comme chef-d’œuvre.
Le génie intrinsèque de Beethoven, Tia de Nora en touche pourtant du doigt, mais sans le dire, certains aspects lorsqu’elle rapporte les témoignages de contemporains qui tous soulignent l’originalité du style de Beethoven aussi bien en tant que pianiste-improvisateur lors de duels qui l’opposèrent à certains de ses confrères que comme compositeur avec des œuvres qui, pour les oreilles de l’époque, tranchaient tant avec celles de ses contemporains que de ses prédécesseurs.
Cette originalité se traduit dans les premières œuvres du compositeur par ce que l’on peut appeler le goût de l’étrange ; certes bien des éléments de cette étrangeté nous sont devenus familiers dans la mesure où ils ont été rapidement acculturés, d’autres en revanche gardent malgré tout leur pouvoir perturbateur.
Pour retrouver l’authenticité de cette étrangeté, comme signe du « nouveau », il faut tenter d’emprunter virtuellement les oreilles d’un homme de la fin du XVIIIe siècle, un Viennois habitué essentiellement à la musique de Haydn, de Mozart et de leurs épigones. Elle permet de voir ce qui, même dès la période de Bonn, distingue et singularise le style de Beethoven.
On remarque ainsi, d’emblée, un goût pour la complexité et ce, dès les Quatuors avec piano WoO 36 de 1784, que ce soit dans le choix d’ornementations inhabituellement intriquées dans le langage de cette époque (Adagio du Quatuor WoO 36 n° 3) ou de tonalités inusitées, comme mi bémol mineur au début du Quatuor WoO 36 n° 1. Mais ce qui frappe surtout – et cela dans la plupart des œuvres – ce sont les ruptures de ton, les irrégularités et de manière générale un rapport subversif à la norme, sans que pourtant ces tendances prolifèrent au point de faire basculer l’écriture vers le désordre.
Cela, tous les contemporains de Beethoven le remarquent et s’en étonnent. Ainsi, selon le flûtiste Louis Drouet qui a assisté à une des premières entrevues du jeune compositeur avec Haydn qui aurait ainsi jugé les premières partitions de son nouvel élève : « On trouvera toujours dans vos œuvres quelque chose, je ne dirai pas de bizarre, mais d’inattendu, d’inhabituel –, certes partout de belles choses, même des choses admirables, mais ici et là quelque chose d’étrange, de sombre, parce que vous êtes vous-même un peu sombre et étrange » (Cité par Jean et Brigitte Massin, op. cit., p. 45).
Dans Les grandes époques créatrices (Albin Michel, I, p. 113), Romain Rolland révèle divers témoignages des jeunes compositeurs de l’époque considérant Beethoven comme un compositeur qui fabriquait « les machines les plus étranges », qui composait « une musique baroque en opposition avec toutes les règles » de telle sorte que « personne ne pouvait ni les jouer, ni les comprendre ». Tomášsek, par exemple remarque dans les œuvres de Beethoven « ses sautes fréquentes et hardies d’un motif à un autre…..l’étrangeté et l’inégalité, ajoute-t-il semblaient être pour lui le principal de la composition » (Cité par Jean et Brigitte Massin, op. cit., p. 78).
Quant à Stendhal de passage Vienne en 1809, il juge que Beethoven a « accumulé les notes et les idées, [qu’il a] recherché la quantité et la bizarrerie des modulations ».
Tia DeNora relève bien certains de ces jugements, mais, une fois encore, elle n’en tire aucune conséquence, notamment en ce qui concerne le pouvoir d’innovation qui se révèle chez Beethoven à travers l’étrangeté de son œuvre, telle qu’elle est perçue d’emblée – dès l’arrivée du compositeur à Vienne – et par tous – détracteurs aussi bien que partisans. Or c’est bien cela qui ne cessera de caractériser la création beethovénienne à tous les stades de son développement, le conduisant aussi bien à se démarquer de ce qui existe, qu’à remettre en question sa propre démarche. Comme l’écrit Boucourechliev, « Dans les Symphonies, comme dans les Quatuors et les Sonates, la démarche créatrice [de Beethoven] est à ré-inventer à chaque œuvre ».
Cet état d’esprit caractéristique du compositeur est bien un élément clef de la singularité du génie beethovénien. Il se distingue ainsi de celui Haydn et de Mozart qui composaient sinon en grande série du moins en suivant des cadres formels donnés qu’ils n’envisageaient pas de mettre fondamentalement en cause, même s’ils pouvaient jouer avec leurs contours.
L’originalité du génie de Beethoven, une convergence exceptionnelle de déterminants
Son problème d’identité, ses relations à l’image paternelle, les « raptus » auxquels Beethoven était sujet dans son adolescence nous semblent donc incomparablement plus déterminants pour l’éclosion de sa personnalité si singulière et pour la « construction » de son génie – dont les premières manifestations évidentes remontent, répétons-le, à la période de Bonn – que ne le furent les soutiens de ses mécènes viennois ; la surdité dont il souffrit moralement et physiquement à partir de 1797 et dont il sut retourner et sublimer les effets, fut infiniment plus riche de conséquences pour la création beethovénienne que les exhibitions du pianiste Beethoven dans les salons de l’aristocratie où, bien au contraire, son génie risquait de se perdre dans l’ivresse des succès.
La structure de la personnalité de Beethoven était d’ailleurs ainsi faite que la créativité du compositeur s’est souvent révélée plus féconde sous la pression d’un défi à relever que d’une stimulation par le succès et les honneurs ; on pourra noter ainsi que jamais la qualité de ses productions n’est tombée aussi bas que dans les années 1815 où, devenu musicien quasi-officiel, Beethoven écrivit dans la mouvance du Congrès de Vienne des œuvres de circonstances qui lui valurent les plus grands succès de sa carrière. Ces tendances caractéristiques de son génie étaient d’ailleurs en harmonie avec la conception que le compositeur se faisait de l’importance de l’effort, d’où l’association qu’il établissait entre la difficulté d’une œuvre et sa beauté. Ainsi écrivait-il en janvier 1817 dans une lettre à Sigmund Anton Steiner : « Ce qui est difficile est en outre beau, bon, grand ». Cela
ne l’empêchait pas, paradoxe apparent, de prôner la nécessité de simplifier : Immer simpler (toujours plus simple), notait-il en marge de certains manuscrit.
Les aristocrates viennois qui soutinrent Beethoven dans ses premières années viennoises ont manifestement fondé d’importants espoir sur les talents du jeune compositeur ; dans cette période de mutation sociale en Europe et de remise en question de l’échelle des valeurs traditionnelles, ils ont certainement misé sur ce roturier de génie pour sauver, à travers la continuation du style classique et une certaine esthétique « sérieuse », leur conception socio-éthique du monde, ainsi que l’avait symboliquement formulé le comte Waldstein. Mais il ne semble pas qu’ils aient fait, de ce point de vue, un choix judicieux.
Beethoven s’est certes révélé musicalement l’héritier de Haydn et Mozart, mais les « nouveaux chemins » qu’il a ouverts l’ont conduit bien loin des horizons supposés du style classique. Qui plus est, la figure de l’artiste que Beethoven a imposée – figure qui devait prévaloir dans tout le XIXe et une partie du XXe siècles – reposait sur des principes opposés à cette sorte de conception d’un artiste de droit divin qui s’était idéalement incarnée en la personne de Mozart.
Les facilités exceptionnelles de Mozart – toutes ses oeuvres, hormis les Quatuors opus 10, on été écrites d’un seul jet et sans rature – accréditaient la thèse classique du génie découvreur de ce qui – don de Dieu – est caché dans la nature. Plus qu’aucun autre le « divin Mozart » est celui qui, sans effort ou du moins avec une incomparable aisance, met au jour l’image du Beau dans la musique. Il exemplifie ainsi dans son art mieux que quiconque le schéma éthique de l’aristocratie qui prône le culte de l’excellence dans son rapport avec l’inné.
Même s’il privilégia les liens de tous types avec l’aristocratie, liens qui purent s’épanouir jusque dans l’amitié (voir par exemple ses relations avec Zmeskall von Domanovecz, dédicataire du Quatuor opus 95 ou avec l’archiduc Rodolphe, dédicataire de la Grande fugue) et l’amour (toutes les femmes qu’il aima étaient d’origine noble), Beethoven, au contraire, ne cessa de croire en une sorte de « méritocratie » à l’évidence d’inspiration démocratique, en harmonie avec son goût pour l’effort et son idéal de volonté qui, loin de répondre à la conception aristocratique du monde s’inscrivent sans ambiguïté dans ce que Luc Ferry appelle « l’éthique moderne » (Homo Aestheticus p. 358).
Si donc les mécènes princiers de Beethoven entendaient se servir du compositeur pour préserver leur idéal de l’art classique, ils ont en fait soutenu, sans en être véritablement conscients, un compositeur qui au-delà de sa liberté de propos et de comportement à leur égard, fut en leur sein une sorte de cheval de Troie d’un modernité dont ils devaient être de facto exclus.
Ainsi, il n’est ni juste ni légitime de laisser entendre comme le fait Tia DeNora que les mécènes viennois de Beethoven ont manipulé le jeune compositeur en « construisant » son génie à leur image ; c’est plutôt l’inverse qui s’est produit. Mais surtout la place de Beethoven dans l’histoire s’explique par la convergence d’un nombre tellement important de déterminants qu’il est non seulement réducteur mais un peu dérisoire de l’expliquer par l’un d’entre eux seulement, le facteur sociologique, lui-même envisagé d’ailleurs de manière partielle.
Le génie est toujours le fruit d’un grand nombre de facteurs tant naturels que culturels. C’est particulièrement vrai dans le cas de Beethoven qui accumule sur sa personne maintes déterminations les unes en apparence positives, comme le soutien de grands mécènes, les autres apparemment négatives, comme la surdité, mais qui toutes jouent dans un sens favorable à l’éclosion et à l’épanouissement de son génie. La présence de nombreux facteurs négatifs – en tout cas par rapport à un idéal de vie harmonieuse – donne à Beethoven le sentiment aigu d’une tension entre le bas et le haut, entre le petit et le grand. C’est là une des explications de l’esthétique du contraste et de l’éthique de dépassement qui sont des clefs de son œuvre.
Si Beethoven ne cesse de s’imposer comme une des grandes figures parmi les génies de l’humanité, c’est sans doute avant tout grâce à ses dons exceptionnels et à ses qualités de musicien qu’il est bon de rappeler puisque Tia DeNora en fait l’économie (doté d’une oreille exceptionnelle avant que la surdité ne l’atteigne, il fut à la fois un des plus remarquables pianistes de son temps, un improvisateur tout à la fois admiré et redouté et une compositeur plus précoce qu’on ne le croit généralement), mais aussi sa personnalité singulière (son tempérament cyclothymique, son caractère obsessionnel, sa volonté farouche de lutteur, son orgueil et sa générosité naturelle) qui ont placé Beethoven en situation de tirer parti artistiquement de toutes les données de son environnement, qu’il s’agisse de l’évolution politique et sociale – dont la nouvelle structure de mécénat n’est qu’un aspect –, de l’émergence d’idées philosophiques et esthétiques nouvelles ou de la qualité de l’héritage musical qui était le sien. Le génie de Beethoven est en partie le résultat de cette convergence exceptionnelle et en partie l’expression d’un mystère tout aussi indéchiffrable que celui de Mozart ou de Bach, chacun radicalement différent.