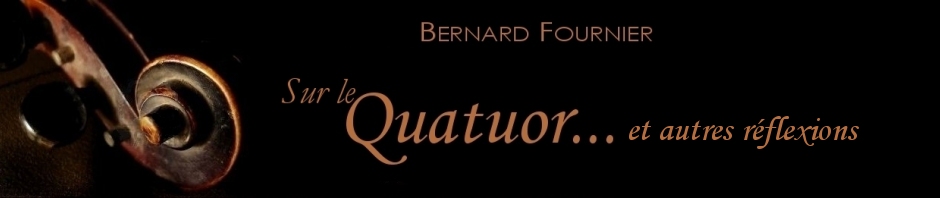Cet article sera publié dans le cahier « spécial sonates » de la revue de L’Association Beethoven France
Les Sonates pour piano, un des trois piliers de la Sagesse beethovénienne
De l’abondante production de Beethoven, se détachent trois grands cycles consacrés chacun à un genre instrumental (la symphonie, le quatuor à cordes, la sonate pour piano) qui tous comportent des œuvres composées au cours de chacune de ses trois grandes périodes créatrices. Cette périodisation est souvent contestée par une musicologie récente, mais nous la tenons toujours pour pertinente et féconde sous réserve que soient prises en compte certaines anticipations fulgurantes de la première période – pensons à La Malinconia du Quatuor opus 18 n° 6 –, certains gestes archaïsants de la troisième (recours au chant grégorien dans l’Et Incarnatus de la Missa Solemnis ; retour à l’architecture classique du Quatuor opus 135) et un certain flou dans le passage d’une période à la suivante, surtout de la deuxième à la troisième.
Plus que d’autres groupes d’œuvres, ces trois-là – les 9 symphonies, les 16 quatuors, les 32 sonates – rendent compte de manière complète de la spiritualité beethovénienne, de sa pensée musicale et philosophique, philosophie prise au sens de Sagesse, comme on parle de la Sagesse égyptienne ou hébraïque. Certes, en dehors des trois grands cycles que nous avons mentionnés comme emblématiques de la Sagesse de Beethoven, il en est d’autres qui recèlent également d’ineffables beautés et qui révèlent aussi des aspects essentiels de la spiritualité beethovénienne, les cinq concertos pour piano (1795-1809), les cinq sonates pour violoncelle et piano (1796-1815), les cinq trios à cordes (1792-1798), les sept trios avec piano (1793-1812) et les dix sonates pour piano et violon (1793-1812). Mais il leur manque – il nous manque dans ces cycles – le mode d’expression du « dernier Beethoven ». Cependant le fait même que son style en évoluant se soit concentré sur des médiums homogènes et monochromes (le piano, le quatuor à cordes), ou au contraire sur le médium le plus hétérogène et le plus coloré (l’orchestre) s’ouvrant aussi à la voix humaine (Missa solemnis, IXe symphonie) nous renseigne sur les tendances d’un homme qui, en vieillissant, d’une part se concentre de plus en plus sur les formes et les genres qui lui semblent le plus appropriés à l’expression de sa propre subjectivité et d’autre part, manie plus que jamais tous les types de contrastes : registre (grave profond / suraigu), de nuance (fff/ppp), masse, couleur, etc. D’ailleurs, en passant sans transition de la pointe sèche du quatuor à la rutilance de l’orchestre, il s’inscrit aussi dans cette problématique du contraste.
Que ce soit dans son écriture ou sa vie, Beethoven a besoin de passer d’un extrême à l’autre.
De même que la fluide et lyrique Symphonie « Pastorale » est contemporaine de la pugnace et dramatique 5e, de même chez l’homme, dans ses relations avec ses proches, le débordement d’affection peut suivre immédiatement la plus violente colère.
On a souvent remarqué que le domaine des sonates pour piano était celui où Beethoven mettait en œuvre le plus tôt ses innovations formelles ou expressives. Et, en effet, y a-t-il un autre genre où l’on trouve avant le Largo de la Sonate opus 7 (1796) un tel lyrisme effusif, avant la Pathétique (1798-99) une telle prégnance des ressorts dramatiques, avant la Sonate « Au clair de lune » (1801) une telle poésie nocturne ? Si oui, ce n’est que dans les Trios à cordes opus 9 qui à maints égards sont des œuvres prémonitoires. De même, les dernières sonates pour piano anticipent les radicales acquisitions du style tardif qui s’épanouira dans les derniers quatuors.
I – Beethoven, penseur et poète en sons
Mais ici, plus que de style, de forme et de langage, nous nous proposons de parler d’expression, même si pour aborder cette question éminemment subjective, on ne peut faire l’économie de références à l’écriture, sans lesquelles on court le risque de se laisser aller au délire interprétatif qui coupe le commentaire de tout lien avec le geste créateur du compositeur comme avec l’universel ; or la tension vers l’universel est une clef fondamentale de la pensée créatrice de Beethoven. Il a certes introduit avec force, dans le domaine musical, la voix d’un « je », mais c’est un je, à la subjectivité universalisante, un je qui parle pour un nous fantasmé. Par ailleurs, si la musique de Beethoven donne souvent l’impression de s’adresser à nous de manière personnelle, elle nous place en même temps dans la nécessité d’un rapport à autrui. Elle se communique à nous en nous soufflant l’ardente obligation de partager avec d’autres cette joie particulière que nous recevons d’elle. L’écoute d’une œuvre de Beethoven – c’est vrai, sans doute, de toute grande œuvre musicale, mais ça l’est plus encore, nous semble-t-il, de celles de Beethoven –, recèle quelque chose de la célébration d’une religion humaniste. La IXe Symphonie est à l’évidence un exemple éclairant et emblématique de cette caractéristique ; mais si on trouve quelque chose de cette tendance messianique dans toute grande œuvre de Beethoven, sans doute est-ce parce qu’au-delà des notes, elle nous introduit à un univers de nature philosophique, au sens où la philosophie est une sagesse, au sens aussi où elle est une recherche de la vérité à travers une éthique, vérité de la vie par conséquent, davantage que vérité de l’être.
Beethoven, qui s’est peu exprimé par écrit avec des mots, a cependant noté que son domaine, celui de la musique, « s’étendait beaucoup plus loin que celui du peintre et du poète » ; il laisse entendre précisément que la musique est une sorte de philosophie dont le langage est formé non pas de mots mais de sons et lui qui se définit comme Tondichter (poète en sons) aurait pu se désigner aussi comme Tondenker (penseur en sons).
Avant d’étudier cidessous comment Beethoven « philosophe » à travers le corpus des sonates pour piano, nous rappelons brièvement ce qu’il a pu nous en donner à connaître non seulement par certains de ses écrits ou de ses propos qui parfois nous donnent de précieuses indications sur ce qu’il attendait en général de son art ou sur ce qu’il lui assignait, mais aussi par son comportement. Pour lui, la musique est l’inverse d’une distraction ou d’un divertissement qui aideraient l’homme à mieux vivre en le détournant de ses problèmes d’existence, en les lui faisant oublier ; selon sa perspective, elle est censée au contraire le placer face aux difficultés de sa condition d’homme ainsi qu’au malaise, au mal-être ou aux souffrances induites par son destin particulier afin qu’il les affronte et les vainque ou les dépasse. Ce programme, qui est au départ celui dont témoigne sa vie d’homme, Beethoven le transpose dans son œuvre de créateur et il lui donne une dimension universelle grâce à laquelle il se voit comme Prométhée ou Bacchus : « Et moi, dit-il à Bettina Brentano, je suis le Bacchus qui vendange le vin dont l’humanité s’enivre ».
C’est là une des leçons du « phénomène » Beethoven, cette tension qu’on ne trouve jamais à un tel degré chez d’autres grands musiciens entre l’expérience de l’homme et l’œuvre. Pour paraphraser Beethoven qui disait à propos du texte de la messe lorsqu’il écrivait la Missa Solemnis : Text und Musik sind eins (Texte et Musique sont uns), on peut dire à son sujet Mensch und Musik sind eins (l’homme et l’œuvre sont uns). Cela ne signifie pas, comme on l’a souvent envisagé, que l’on puisse expliquer l’œuvre par les circonstances de la vie, mais plus profondément, qu’il existe une intime corrélation entre le tempérament de Beethoven et son écriture. Cette corrélation qui existe certes toujours jusqu’à un certain point, comme l’indique la célèbre formule « le style c’est l’homme », n’a jamais été, semble-t-il, aussi étroite, aussi nécessaire et aussi opératoire que chez Beethoven.
II – Rôle et place des sonates pour piano dans la pensée beethovénienne
Pendant très longtemps dans la carrière du compositeur, la sonate pour piano a été à la fois son mode d’expression le plus intime et son laboratoire le plus avancé, notamment pendant sa première période créatrice. Cela se traduit le plus visiblement dans l’ordre du quantitatif si l’on compare le nombre les sonates composées pendant chacune des trois périodes
1ère manière 1792-1802 20 sonates
2e manière 1803-1815 7 sonates
3e manière 1816-1827 5 sonates
Pendant la première période créatrice de Beethoven, l’écriture des sonates pour piano forme la pointe extrême de sa poétique, même si les trios à cordes ou les quatuors déjà peuvent montrer des avancées stupéfiantes. Pendant la deuxième, un équilibre s’établit entre sonates, symphonies et quatuors : l’émergence du style héroïque se traduit à peu près en même temps et avec la même force dans la 3e Symphonie, dans la Sonate « Appassionata » et dans les Quatuors « Razoumovski ». Écrites au début de la dernière période (1816-1822), les cinq ultimes sonates – les Opus 101 à 111 –, portent et mettent en œuvre nombre des tendances du style tardif qui connaîtra ensuite ses bouleversements les plus radicaux dans la Missa Solemnis et les derniers quatuors.
C’est pourquoi, il semble particulièrement intéressant d’étudier, dans le domaine des sonates, l’émergence et le développement des multiples acquisitions de l’esthétique et du langage beethovéniens et notamment de ce qui fera une des plus remarquables spécificités des grandes œuvres de la dernière manière du compositeur, leur aptitude à affirmer une pensée musicale, une pensée en sons qui exprime, à travers un au-delà des mots, un au-delà de la conscience.
Cette aptitude de Beethoven à faire de la musique un véhicule de la « pensée des profondeurs » mais aussi une médiatrice sensible et sensuelle de la vie de l’esprit , a contribué à ce que, à l’instar de la thèse de Claude Lévi-Straus , il soit considéré comme le héraut d’une musique du message. Cette conception certes tout à fait pertinente a entraîné bien des malentendus et, comme toujours avec Beethoven – personnalité éminemment dialectique –, il faut aussi regarder l’envers de cette proposition qui, énoncée sans précaution, pourrait légitimer qu’on le prenne pour un compositeur dogmatique ce qu’il n’est pas du tout ou messianique ce qu’il n’est qu’épisodiquement, car s’il est un « penseur en sons », il est tout autant un Tondichter (poète en sons) : pour lui, la musique, par essence, est avant tout un art de l’invisible et de l’impalpable. Négliger un de ces deux pôles de son génie, c’est non seulement le réduire, mais le défigurer et même le falsifier.
Elle est en effet fondamentale pour appréhender la personnalité artistique de Beethoven cette tension entre sa conception poétique de la musique et l’ambition philosophique qu’il lui assigne. Elle le conduit à cheminer périlleusement entre ces deux mondes opposés sur un fil haut perché, sans qu’il tombe ni du côté d’une certaine musique conceptuelle ou d’une musique de l’idée dont le contenu expressif suscite à l’envi gloses verbalisantes ou rhétoriques dogmatiques, ni du côté de l’art pour l’art, de celui d’une poésie qui ne serait que voluptueuse beauté sonore.
À cette féconde dualité philosophique et poétique, s’ajoute le tempérament cyclothymique de Beethoven qui soumet son œuvre au contraste radical ou à la rupture et la place aussi sous le régime de l’événement.
Cependant toutes ces dispositions formelles et d’écriture ne sont certainement pas le fruit de réflexions systématiques. Pas plus que les rares compositeurs de son envergure (Bach, Mozart), Beethoven n’a théorisé. Son évolution technique et esthétique, s’est faite essentiellement à travers la pratique de la composition avec un très important travail dont les esquisses nous donnent un aperçu ; elle s’est donc faite de manière expérimentale dans le secret de sa conscience artistique et dans l’intimité de son « laboratoire ».
Ce sont ensuite, les critiques, les musicologues qui, à travers leur analyse a posteriori des œuvres, découvrent des règles, des lois formelles et des principes esthétiques. Quant aux compositeurs qui viennent après ces géants, ils en tirent des leçons, mais en s’affranchissant, pour les meilleurs, de toute perspective d’imitation.
Ce geste musical de la pensée en action, c’est dans les sonates pour piano que nous le voyons se manifester d’abord et cela dès l’Opus 2 ; mais plutôt que d’en examiner la nature et la signification dans chacun des 32 chefsd’œuvre de Beethoven, nous nous limiterons à 6 d’entre elles dont nous étudierons certains moments.
Afin que la lecture de ce texte puisse se montrer fructueuse pour le lecteur nous fonderons nos commentaires sur des exemples précis dont nous donnerons les références aussi bien par leur numéro de mesure dans la partition que des minutages relevés sur des enregistrements de ces sonates que nous jugeons comme faisant partie des meilleurs et en même temps facilement accessibles par leur diffusion. À des versions très anciennes parfois tout à fait remarquables (Arthur Schnabel, Wilhelm Backhaus, Wilhelm Kempf, Yves Nat, Daniel Barenboim, etc., nous avons préféré des versions récentes. Nous hésitions entre Maurizio Pollini et Stephan Kovacevics et avons retenu Pollini, que l’on trouve plus facilement sauf pour la Sonate opus 7 dont nous avons choisi la version d’Abdel Rahman El Bacha, membre du comité d’honneur de l’Association Beethoven France, tout en regrettant qu’il n’exécute pas toutes les reprises indiquées par Beethoven, notamment celle de l’exposition du premier mouvement.
III – Quelques gestes de la pensée musicale en action dans six grandes sonates
Hormis sa beauté propre, chacune des 32 sonates se distingue par des moments privilégiés où la pensée musicale du compositeur se manifeste en des gestes formels ou langagiers d’une grande force expressive. Parmi tous ceux, très nombreux, qui jalonnent les sonates pour piano, nous en avons choisi quelques-uns relevés dans six grandes sonates – deux de chacune des trois périodes créatrices –, que nous commenterons en nous focalisant sur certaines figures ou sur certains gestes particulièrement emblématiques de la poétique beethovénienne.
I – Sonate opus 7 (1797), notes répétées, grands intervalles
Beethoven l’appelait « la Grande » – grande, elle l’est tant par la durée que par le contenu à la fois riche et diversifié – mais elle fut aussi baptisée « l’Amoureuse » ; ceci expliquant peut-être cela, elle est dédiée à une belle et talentueuse élève de Beethoven Babette von Keglevics dont il fut sans doute amoureux. Mais au-delà de l’anecdote, l’œuvre se montre à la fois novatrice – Beethoven s’éloigne non seulement de Haydn et Mozart, mais de son propre Opus 2 – et porteuse d’une intense passion, une autre façon de parler d’énergie, maître mot de cette sonate sous ses deux aspects extériorisé et intériorisé.
Remarquons au fil de l’œuvre, hormis de nombreux contrastes abrupts – expression d’énergie brute -, deux singularités fortes qui se révéleront d’ailleurs être des caractéristiques du style beethovénien tout au long de sa carrière. Il s’agit de deux figures (notes répétées et grands intervalles) dont cette sonate est peut-être le lieu d’émergence le plus significatif, même si les sonates précédentes sont loin d’être exemptes de tels signes énergétiques. Mais dans l’Opus 7, ils sont sans doute plus radicaux et surtout davantage intégrés dans un système de pensée.
Notes répétées
Les figures de notes répétées n’y ont pas seulement une valeur en soi – expression de force, signal ou signe–, elles sont l’élément moteur d’un processus d’engendrement, si bien que d’une certaine manière, dans le 1er mouvement (Allegro molto e con brio) elles portent le noyau de sens.
Au début de la sonate, comme plus tard dans la « Waldstein », une ligne de notes répétées à la main gauche libère l’élément mélodique du premier thème qui consiste ici en un motif volubile. Plus loin (mes. 79 [1’20] ) et à l’inverse, une digue de notes répétées sous forme d’accords de sept sons arrête un processus effréné (descente crescendo d’un motif itératif). Le développement puise par trois fois son énergie (mes. 137 [2’18], mes. 189 [3’]) ou une nouvelle respiration (mes.169 [2’50]) dans le processus initial. Tout comme la réexposition, symétrique à l’exposition du point de vue de ces deux processus énergétiques (engendrement et, à l’inverse, blocage), il prend pour argument une figure de notes répétées. La coda réinterprète le premier (notes répétées) aussi bien en son début où il s’essouffle (mes. 313 [5’20]) que dans sa péroraison où il se renforce (mes. 351 [6’01]). Il est tentant de formuler l’hypothèse que, dans ce mouvement d’une grande richesse motivique, tous les détours de la pensée sont commandés – et que la pensée elle-même est mise en mouvement – par le ruban initial de notes répétées, sorte de principe vital en action dont certains exemples empruntés à d’autres sonates (Waldstein, Appassionata, Opus 110) permettront d’éclairer sous d’autres angles le champ de lumières nouvelles, de mieux comprendre la pleine signification de cette figure chez Beethoven. Certes bien d’autres compositeurs avant lui – Haydn et Mozart notamment – ont eu recours à des motifs de notes répétées. Mais nous n’en connaissons pas ni avant lui, ni après lui (même si l’on songe à Bartók dans l’œuvre duquel la répétition de notes joue un rôle essentiel) qui ait donné à cet élément du vocabulaire musical un éventail aussi large et profond de significations esthétiques et philosophiques.
Grands intervalles
À plusieurs reprises dans la sonate, Beethoven déploie un grand intervalle (très supérieur à une octave) qui donne l’impression d’un soudain envol, d’un jaillissement, mais aussi d’un vide, d’une béance, comme s’il faisait entendre le vertige des cimes ou des gouffres.
C’est le cas dans l’Allegro, où sur une ligne staccato de la main gauche du piano et en réponse à un saut de septième (mes. 41 [41’’]), le 2e groupe thématique libère, à deux reprises, un intervalle ascendant de 13e (mes. 51 [51’’], mes. 53 [53’’]). Beethoven rend ici sensible de manière très nette la notion d’espace musical. La hauteur d’un son ne vaut pas seulement pour sa valeur syntaxique dans le langage mélodico-harmonique, mais pour sa position plus ou moins élevée dans l’espace musical. Nous transporter ainsi de manière quasi instantanée en un point très éloigné du point de départ, nous donne à percevoir de la musique autre chose que le charme mélodique ou la pugnacité rythmique. La pensée musicale se saisit d’une dimension physique et presque corporelle, celle d’un geste d’ascension rapide
Dans le Largo, l’intervalle déployé (mes. 37 [2’54]) est encore plus large (15e) et le saut mélodique qui le détermine est souligné par un puissant contraste de nuance (forte dans le grave, pianissimo dans l’aigu). Ici l’impression de jaillissement est supplantée dans l’esprit de l’auditeur par celle de couleur. Les deux mi bémols aigus appogiaturés sonnent comme des tintements de cloche avec une aura de mystère qui en font une précieuse invention de ce Tondichter qu’est déjà Beethoven. Hissé vers les cimes par ces deux notes – énoncées à trois reprises, elles résonnent dans le silence –, le discours y demeure pour une « fausse réexposition » à la Haydn du thème (mes. 42 [3’15]), thème dont il faut dire qu’une de ses beautés tient précisément à la manière dont il est écrit avec des figures de silence qui participent d’une esthétique du silence.
De même que les notes répétées, le grand intervalle constitue une figure emblématique de la poétique beethovénienne que nous retrouverons aussi dans d’autres sonates et qui prendra toute sa valeur et s’exprimera avec une puissance stupéfiante dans les œuvres de la dernière manière, particulièrement dans l’Opus 111.
Pour l’instant nous allons nous arrêter sur une sonate, l’Opus 31 n° 2, qui échappe à l’une et l’autre de ces problématiques et qui introduit de manière décisive dans l’univers des sonates, celles des ruptures de tempo et des ruptures discursives avec l’apparition du récitatif, issu de l’opéra et utilisé par Beethoven comme véhicule privilégié de la communication intime, du parlando d’âme à âme.
2 – Sonate « La tempête », tempo et récitatif
La Dix-septième sonate pour piano appartient à un groupe de 3 sonates qui furent publiées en 1804 sous le numéro d’opus 31. Les deux premières, déjà publiées à Zürich par Naegeli en 1803, avaient sans doute été esquissées dès la fin de 1801.
Écrite pour l’essentiel en 1802, la Sonate opus 31 n° 2 en ré mineur tire peut-être le caractère dramatique de son premier mouvement de l’état d’esprit du compositeur qui, cette année-là, traverse une crise particulièrement grave que reflétera la rédaction du Testament d’Heiligenstadt (6 octobre 1802). L’origine de cette crise, c’est la prise de conscience par Beethoven que le symptôme de la surdité – dont il perçoit les premiers signes depuis quelques années (1796) – prend un caractère permanent et irréversible.
Interrogé par Schindler sur la signification de l’œuvre, Beethoven répondit – comme il le fera d’ailleurs pour la Sonate Appassionata : « Lisez La Tempête de Shakespeare ».
On peut penser que Beethoven était sensible à la vision du monde qui s’exprime dans la Tempête avec son idéal d’harmonie, de justice, même si cette dernière est rétablie au moyen d’un rite expiatoire ; mais l’œuvre musicale telle que Beethoven la conçoit et surtout l’œuvre instrumentale ne peut être l’illustration seconde d’une idée : elle doit être consubstantielle à l’idée qui est essentiellement une idée musicale. Cependant sur la nature et les liens de certains personnages de la pièce de Shakespeare peuvent éclairer certaines conceptions beethovéniennnes de l’art : Ariel joue une musique qui fascine ceux qui l’écoutent, mais sans sa volonté et le pouvoir de Prospero, cet esprit de l’air n’existe pas. À eux deux, ils représentent sans doute pour Beethoven de possibles images du pouvoir de l’inspiration créatrice sur la réalité. À ce titre, la référence à La Tempête – qui pourrait valoir pour toute grande œuvre de Beethoven – traduit peut-être simplement l’idée que le compositeur se fait de son travail ou de son rôle. Mais il n’est pas indifférent que Beethoven ait mentionné le chef-d’œuvre de Shakespeare à propos de deux sonates qui marquent une progression sensible dans sa manière d’envisager l’écriture pour le piano.
Dans la Sonate opus 31 n° 2, c’est le Ier mouvement qui porte l’essentiel des innovations du compositeur, innovations formelles qui se traduisent par une nouvelle façon de penser la musique mais aussi d’être à l’écoute de la musique qui pense.
La 17e Sonate est la deuxième après la 8e Sonate « Pathétique » à commencer par une introduction lente. Mais les modalités mises en œuvre dans la sonate en ré mineur sont tout autres que dans celle en ut mineur.
Si « La Tempête » s’affirme comme une œuvre charnière dans la carrière de Beethoven et quelque peu révolutionnaire, c’est que ses deux principales innovations rompent avec des principes essentiels qui régissent l’esthétique classique, l’unité de tempo et la continuité discursive. Ici, nous ne voulons pas seulement souligner les innovations introduites par Beethoven, comme arguments de la modernité de l’œuvre, mais examiner en quoi elles nous disent ou plutôt nous suggèrent quelque chose de la pensée de Beethoven, de sa conception de l’homme et de la vie, c’est-à-dire de sa philosophie, non pas en tant que spéculation – ce dont la musique est incapable –, mais en tant que sagesse, morale éthique, règle de vie, leçon de spiritualité.
1 – Tempo
Le premier mouvement s’affirme du point de vue du tempo comme une des pages les plus hétérogènes du style classique, le précédent le plus proche étant « La Malinconia » du Quatuor opus 18 n° 6. Les œuvres du classicisme (1760-1802) respectent grosso modo un équivalent de la règle des trois unités théâtrales, unité de temps, de lieu et d’action, ce qui se traduit en musique par une unité de tempo, de contenu expressif ou de continuité discursive (brisure du flux mélodique, des lignes mais aussi, plus substantiellement, changement du « niveau de langue », la langue musicale étant par excellence le lieu où se développe la pensée) et de métrique. Concernant cette dernière, la pulsation induite par le rythme spécifique du mouvement peut être considérée comme un équivalent de l’action à laquelle il est permis d’ailleurs d’en associer d’autres, relatives au matériau de base (l’introduction de matériaux étrangers à la logique de l’œuvre, peut aussi jouer ce rôle).
Au cours de sa carrière, Beethoven sera amené à briser chacune de ces trois unités, ce qui se produit de manière courante, mais avec des modalités chaque fois différente dans les œuvres de la dernière manière ; dans le premier mouvement de « La Tempête », il en bouscule déjà deux, le tempo et la continuité discursive.
Quelques œuvres classiques, de Haydn, de Mozart, notamment, font précéder leur premier mouvement, un allegro de forme sonate, d’une introduction lente. Mais une fois énoncée, il n’y est plus fait référence. En outre, il s’agit plutôt d’un prélude que d’une introduction en ce sens, qu’une fois énoncée, il n’est plus fait allusion. Avec Beethoven, à partir de cette sonate, bien plus qu’avec « La Pathétique », l’introduction fournit une partie essentielle du matériau de base du mouvement. L’arpège d’ouverture du Largo initial constitue la matière du thème principal de l’Allegro qui n’apparaîtra, en tant que tel, que près d’une minute plus tard. L’arpège initial, égrène très lentement [13’’] les notes d’un accord de sixte dont le la d’arrivée est suspendu par un point d’orgue.
Le Largo qui ouvre l’Opus 31 n° 2 est formé d’un accord arpégé de sixte (do dièse, mi, la ) débouchant sur la projection horizontale de cet arpège dont la dernière note (la) est suspendue par un point d’orgue. Cette procédure introduit d’emblée une dimension réflexive ou méditative aussi bien à cause de la lenteur de l’égrènement des notes, que de l’indétermination tonale et de la suspension du discours (point d’orgue).
Surgit alors (mes. 3 [14’’]) un premier Allegro de 3 mesures formé à partir d’un doublet de croches conjointes descendantes donnant un sentiment de hâte fiévreuse et d’agitation croissante (crescendo) jusqu’à ce qu’un sol dièse inattendu (mes. 6 [17’’]) vienne arrêter le processus, ce que confirme l’avènement d’un nouveau tempo (Adagio) marqué par un sfz sur le sol dièse dédoublé et l’affirmation de la tonalité de la majeur suspendue à son tour à un point d’orgue. Le discours éminemment décidé et pugnace du bref Allegro est à la fois le fruit d’une réflexion liminaire grave et concentrée et l’objet d’une mise en doute. La survenue de l’Adagio (mes. 6 [17’’]) qui brise l’élan semble dire « À quoi bon cette action, cette effervescence ? » ; il y a déjà là quelque chose du futur Nicht dieses Töne de la IXe Symphonie, par lequel le baryton récuse le passé du discours musical.
Mais le renoncement ne sied pas à Beethoven. Le geste du Largo recommence alors (mes. 7 [25’’]) avec l’accord de sixte mi-sol-do, lui aussi indéterminé , lui aussi suspendu à un point d’orgue et situé une tierce mineure au-dessus du précédent, comme si le discours cherchait, grâce à diverses tentatives et par approximations successives le ton juste, sa position dans l’espace et peut-être également sa légitimité.
Un deuxième Allegro s’élance alors (mes. 8 [37’’]) formé sur le même dessin rythmique mais avec une acquisition de l’espace par intervalles de plus en plus grands (ils croissent progressivement de la seconde originelle à l’octave) avec prolifération des intervalles ascendants qui rompent la continuité de la ligne descendante apportant un élargissement de l’ambitus , une accroissement de l’effervescence et le sentiment tout à la fois de tendre vers un dénouement du processus et de participer à un engendrement : c’est ainsi que le thème principal va s’imposer maintenant tout en affirmant pour la première fois, à la mesure 21, la tonalité fondamentale de l’œuvre, ré mineur.
Cette mise en scène sans précédent dans la forme sonate témoigne de l’art de Beethoven dans la maîtrise du temps musical et de ses conséquences sur la valorisation du matériau. Présenté au terme d’une série de processus complexes – après des détours réflexifs où le compositeur nous rend complice de ses hésitations sur la forme à donner à son matériau, où il l’élabore en quelque sorte devant nous, ce matériau thématique si simple , trouve au terme de cette histoire qui l’a fait naître, la force d’une évidence et la vigueur de toute cette énergie qui, lentement accumulée pendant 20 mesures, s’exprime maintenant de manière irrésistible.
Outre la longue préparation de l’avènement du thème , ce qui est nouveau dans La Tempête c’est à la fois la grandeur du ton et le caractère inexorable de l’énoncé bref, simple (sans fioriture) et récurrent qui connote une sorte de Fatum tragique.
2 – Récitatifs
La situation d’ouverture du mouvement et les interrogations qu’elle pose seront réinterprétées à deux reprises au début du développement et de la réexposition. Chaque fois Beethoven redistribue les cartes, pose d’autres questions, propose d’autres solutions qui sont l’expression de sa pensée créatrice qui apparaît comme une réflexion sur les conditions et la nature de l’action et les mécanismes de la délibération intime.
Développement
Au début du développement, Beethoven pose à nouveau les conditions de la mise en jeu du discours. L’accord arpégé du Largo revient à trois reprises (mes. 93 [4’06] ; mes. 95 [4’21] ; mes. 92 [4’36]) sans aucune interpolation ou entremise d’un « essai » Allegro équivalent à celui de l’exposition. Les trois largos s’enchaînent en restant dans le même ordre de pensée, une pensée réflexive qui trouve en elle-même ses propres arguments de doute. Qui plus est après le 3e Largo, Beethoven continue à faire l’économie du motif à base de doublets de croches. S’enchaîne directement ff, au dernier Largo, une incarnation du thème principal qui se trouve pris alors dans processus de modulation caractéristique de cette partie du discours.
Réexposition
Après un passage quasi choral en rondes (mes. 133 [5’27]) puis un grave unisson (mes. 139 [5’35]) qui terminent le développement, s’amorce logiquement la réexposition avec le retour d’un Largo (mes. 143 [5’41]) au départ strictement équivalent à celui du début. Mais au lieu d’un point d’orgue suspensif sur le la d’arrivée, voici que commence un récitatif (mes. 144 [5’52]), noté par Beethoven con espressione e semplice. Le discours se limite pendant cinq mesures à une ligne mélodique toute nue, c’est¬-à-¬dire sans accompagnement, quelque peu brouillée par la résonance de la pédale dont Beethoven demande qu’elle soit tenue, créant des dissonances d’arrière¬-plan entre les notes de l’accord (la¬-do#-¬mi) et certaines notes du récitatif. Dans ce passage envoutant, extrêmement difficile à exécuter, Beethoven atteint à un degré inégalé de dialogue intime d’âme à âme où se communiquent des choses graves et indicibles. Après un point d’orgue sur un silence, cette fois, l’Allegro avec ses doublets de croches prend son essor, se suspend dans un Adagio (mes. 152 [6’29]) comme celui de la mesure 6. Une deuxième occurrence du Largo à récitatif reprend (mes. 153 [6’31), le récitatif adoptant alors une forme qui anticipe celui de la future IXe Symphonie (mes. 156 [6’54]), notamment. Ellipse est faite de l’Allegro à base de doublets de croches ainsi d’ailleurs que du thème principal en ré mineur. Au lieu de cela, un bloc de quatre accords massifs qui libèrent un flux zigzagant d’arpèges et cela à trois reprises jusqu’à l’arrivée du 2e thème en ré mineur (mes. 172 [7’29]).
oOo
On voit combien dans ce mouvement, le mécanisme d’opposition de tempo, loin de se réduire à une simple opposition de caractère ou de paysage esthétique, constitue le centre vital de l’écriture, l’idée à partir de laquelle le discours à la fois s’engendre et se développe, le moyen à travers lequel Beethoven parvient à traduire dans cette abstraction sensible qu’est le langage musical, tout un monde intérieur, un monde où les délibérations des voix de l’âme engendrent aussi bien méditations que tempêtes, et où les forces paroxysmiques qui se déchaînent trouvent dans ce travail de catharsis qu’est l’écriture, leur apaisement.
Faut-il voir dans le drame musical qui se joue au cours du premier mouvement de la Sonate opus 31 n° 2 une expression du drame intérieur que vit Beethoven confronté à son mal fatal ? Ce n’est qu’une hypothèse et la musique dans son universalité et sa force expressive dépasse toute situation contingente aussi émouvante soit-elle. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que la musique dans son inaptitude à rendre compte d’un sujet ou d’une intrigue, apparaît ici bien au contraire comme un moyen d’expression puissant pour une pensée dramatique dans tout ce qu’elle peut avoir d’abstrait et d’universel.
3 – Sonate « Waldstein » (1803-1804), notes répétées
À l’instar de la Sonate opus 7, la Sonate opus 53, dite « Waldstein », parce qu’elle est dédiée au comte Waldstein, commence [0’00/2’13] par une ligne de notes répétées (série d’accords identiques de 4 sons). Au bout d’un certain temps (15e note), la répétition se dénoue, la ligne supérieure de l’accord se hausse d’un ton et libère un motif de 4 notes dans le grave, auquel répond un motif de cinq notes dans l’aigu. Le même processus reprend à la contre-exposition (mes.14 [24’’/2’34]) avec des répétitions de notes alternées – au lieu de notes simples en batterie –, créant un effet de trémolo. Dans la codetta , le procédé connaît une nouvelle évolution, les notes alternées (mes. 68 [1’45/3’55]) se transformant en trille à la main gauche (mes. 72 [1’50/4’01]). Mais l’idée est la même, celle d’une primauté du rythme (In principio erat rhythmus semble dire Beethoven) et celle de la fécondité de la répétition du « même » comme argument primordial ou privilégié d’engendrement. De même que Moïse frappe le rocher pour qu’en jaillisse l’eau, Beethoven martèle la matière sonore pour en faire jaillir le flux mélodique. Parmi les vertus du trille beethovénien de la dernière manière, il y a aussi celle-là, une répétition frénétique du battement de deux notes jusqu’à ce qu’il en découle quelque chose d’autre. Ce sera une des fonctions du trille incandescent de l’Arietta de l’Opus 111 dont il sera question dans la dernière partie de cet article.
Le mécanisme, à base de notes répétées puis de trémolos, sera repris et intensifié au début du développement (mes. 90 [4’29] sqq.) où il fait naître non seulement les motifs habituels depuis l’exposition et sa reprise, mais des couleurs car le processus répétitif est au cœur du système de modulations harmoniques qui prévaut dans ce passage.
L’arrivée de la réexposition est précédée par une séquence d’une extrême tension où les motifs thématiques morcelés se recomposent sur un ostinato de quatre notes graves répétées à l’identique plus de 30 fois (à partir de la mesure 146 [5’48]). Ce processus, répétitif à deux niveaux, a comme objet – hormis la manifestation de sa propre puissance expressive – de ramener les batteries de notes répétées qui marquent le début de la réexposition (mes. 156 [6’01]). Cette partie suit son cours comme l’exposition avec des variantes sur lesquelles nous ne nous arrêterons pas, pour en venir à la coda (mes. 249 [8’26]), théâtre d’événements notables. Les batteries reprennent comme au début de l’exposition quoique dans une autre tonalité ; mais surtout le jeu motivique de questions-réponses entre motif dans le grave et motif dans l’aigu se trouve perturbé par l’irruption soudaine de coups de boutoir forte sur le motif aigu (mes. 252 [8’29], mes. 254 [8’32]) jusqu’à ce que la ligne thématique se déploie dans le ff (mes. 257 [8’36]). Un piano subit (mes. 259 [8’39]) coïncide avec un changement de couleur des batteries qui, de sombres, tempétueuses et épaisses qu’elles étaient, deviennent fines, calmes et transparentes (simple octave), jusqu’à ce qu’un crescendo fasse naître une ligne syncopée dans un soudain pianissimo suspendu. L’ultime rentrée des batteries (mes. 295 [9’45]) – un peu par surprise car elles rompent l’enchantement des valeurs longues du deuxième thème au parfum de choral hiératique – retrouve la couleur du début de l’exposition (alors dans une lumière plus claire grâce au registre plus aigu des notes supérieures de l’accord), mais coupe court assez sèchement au développement que l’on pouvait attendre qui se trouve noyé sous un déluge de doubles croches ff finalement endigué par quatre accords massifs.
Il y a bien sûr une multitude de grilles d’analyse possibles pour cette sonate, mais celle-ci montre bien le combat créateur de Beethoven avec la matière sonore pour en faire jaillir du sens et de l’émotion.
4 – Sonate Appassionata (1804-1805), mise en doute, notes répétées, contrastes
Considérée par tous les commentateurs, à commencer par Romain Rolland, comme la plus parfaite des sonates de Beethoven composées à cette date (1805) la Sonate opus 57 dite Appassionata, constitue – avec la 3e Symphonie et les Quatuors « Razoumovski » – un des fers de lance du style héroïque qui émerge à partir de 1803. Nous pointerons certains aspects de l’écriture de ce chef-d’œuvre où les notes répétées jouent encore un rôle essentiel, mais également les contrastes puissants et les oppositions radicales qui sont des manifestations de la pensée en action dans lesquelles des idées de nature philosophique sont pensées en actes musicaux.
Cette pensée en mouvement, tout sauf figée par l’écriture, s’incarne magnifiquement dans les premières mesures de l’œuvre où le thème est exposé deux fois de manière identique, mais dans deux éclairages différents, la deuxième occurrence (mes. 5 [11’’]) étant haussée d’un demi-ton par rapport à la première. C’est comme si le compositeur « essayait » une idée puis la reformulait. Ce geste – dont Beethoven reprendra, peu de temps après, le principe au début du Quatuor opus 59 n° 2 (1806) – porte l’idée de « mise à l’essai » d’un matériau thématique – équivalent de la « mise en doute » philosophique d’une proposition – et donne aussi à un discours, par ailleurs puissamment structuré, un parfum d’improvisation. Cette mise en doute se focalise ensuite sur la fin de la phrase, une petite ogive de sept notes articulées autour d’un trille (mes. 7 [19’’], 9 [23’’], 11 [27’’]).
Exacerbant le sentiment d’incertitude ou le transformant en questionnement inquiet, une cellule de quatre notes, dont trois répétées – anticipation du futur thème dit « du destin » de la 5e Symphonie (1807) – ponctue la 2e (mes. 10 [24’’]) et plus encore la 3e de ces occurrences (mes. 12 [29’’]). Ce motif qui n’a en soi rien d’original (c’est presque un topos du style classique, utilisé par Mozart, plus encore par Haydn mais aussi par le jeune Beethoven dès l’Opus 3), acquiert ici par sa mise en scène, une puissance dramatique considérable qui en fait un élément-clef et spécifique de la force de frappe du style héroïque. Il est intéressant de noter qu’avant la Symphonie en ut mineur, c’est dans la Sonate « Appassionata » que, remodelé par Beethoven, ce motif banal prend le visage caractéristique grâce auquel il deviendra l’emblème le plus universellement reconnu du compositeur. En l’occurrence, le motif est d’abord bien isolé par des silences – avant et surtout après lui – qui permettent d’entendre intérieurement sa résonance rendue plus expressive encore par la nuance pianissimo ; puis il est repris par deux fois dans la même nuance et dans un tempo qui, ralentissant, donne plus de poids encore à cet événement : il devient l’argument d’un dialogue entre la main gauche et la main droite du piano, le grave profond et l’aigu à plus de trois octaves au-dessus, extraordinaire moment de tension dramatique et de suspens. Cette scène sera rejouée et intensifiée dans la coda (mes. 235-238) où Beethoven exacerbera encore le dramatisme en recourant à des oppositions radicales et abruptes : après deux occurrences enchaînées dans le grave (mes. 237 [8’21]), le motif de 4 notes est exposé en accords de 4 sons pp dans l’énonciation extrêmement lente, note à note, d’un adagio (mes. 238 [8’23]) ; puis soudain (mes. 239 [8’32]), il est repris en accords ff de sept sons, dans un tempo plus rapide (Più Allegro) que celui de départ (Allegro assai). Cet intense déploiement d’énergie place l’auditeur dans un état de sidération ; il est comme livré, pieds et poings liés, à la volonté du compositeur, soumis à sa temporalité.
Incomparable architecte du temps, Beethoven conçoit de manière différente l’organisation des événements dans l’exposition et dans la réexposition (mes. 134) où, au lieu d’être isolé, le motif emblématique se trouve sous-tendu par un continuum de notes répétées (mes. 145 [5’08], mes. 147 [ 5’12]), mes 148 [ 5’14]. C’est là une conséquence de la manière dont se termine le développement où pendant quatre mesures, le motif ff dialogue avec lui-même (graves contre aigus) à travers une trame pourtant opaque de trémolos (mes. 130-133 [4’374’46]). Trémolos (répétitions de notes alternées) et motif emblématique (fait de notes répétées) cohabitent en un déploiement sonore fulgurant puis convergent vers une ligne continue de notes répétées piano (mes. 134 [4’46]) sur laquelle sourd le thème pp (mes. 136 [4’48]).
Pour finir ces quelques réflexions sur le 1er mouvement de l’Appassionata, revenons en arrière pour observer comment Beethoven, capable de déchaîner les éléments en violentes tempêtes – comme dans le passage qui précède la réexposition –, se montre tout aussi capable, et c’est peut-être encore plus impressionnant, de les dompter. Au début de l’exposition, la 5e occurrence du motif emblématique (mes. 13 [ 33’’]) éclate en un soudain forte qui libère un torrent de doubles croches s’effondrant sur plus de cinq octaves en arpèges brisés avec un puissant rebond ascendant qu’endigue un accord forte, lui aussi, et incisif (croche). Après un bref silence voilà que s’étale longuement (durée plus de dix fois plus longue ) un accord piano. En en seul geste le déferlement est arrêté net et l’effervescence est apaisée. Le mouvement torrentiel et claironnant est devenu stase quasi silencieuse. C’est comme si Beethoven était un aurige capable d’arrêter d’un seul geste et d’immobiliser instantanément ses chevaux au galop, exploit plus impressionnant et demandant plus d’énergie encore que de lancer des chevaux au galop.
La philosophie qui émane des passages que nous avons commentés dans cette sonate est plus de l’ordre d’une éthique de l’énergie et d’une morale de la volonté que chacun pourra interpréter selon sa propre subjectivité que d’une métaphysique, comme on pourra la trouver dans les dernières sonates.
5 – Sonate opus 110 (1821), récitatif, notes répétées et accords
Chacune des cinq dernières sonates (les Opus 101, 106, 109, 110, 111) nous offre dans son mouvement lent une de ces grandes méditations métaphysique quasi pascaliennes qui donnent à ces pages une spécificité inimitable. Pourtant, certains des successeurs de Beethoven s’en sont inspirés, mais aucun n’a retrouvé la gravité et la profondeur de pensée de ces œuvres car, soit elles sont affectées – surtout au XIXe siècle – par un argument sentimental qui les oriente plus vers la confession d’un musicien du siècle, soit, au contraire, elles prennent, chez certains compositeurs du XXe siècle, une tournure plus abstraite qui les arrache au monde sensible.
Ce qui est unique chez le dernier Beethoven, c’est ce point d’équilibre entre l’intellect et l’affect, entre la « pensée logique » et la « pensée affective » dont parle Musil . Sortiront de ce dilemme ceux qui, tel Bartók, musicien de l’énergie comme Beethoven, ou tels certains poéticiens du son tel Debussy puis, par exemple Nono ou plus récemment Lachenmann, repenseront la musique à travers les gestes du corps en déclinant, en leur for intérieur pour former leur style, tous les sons du corps qui vont du cri au soupir et ceux de la nature qui vont de l’ouragan au plus infime bruissement des feuilles dans le vent ou des insectes dans la nuit.
Pour ceux-là encore Beethoven est un modèle, mais dans des pages rares de ses dernières sonates et surtout de ses derniers quatuors où il faut savoir être attentifs à son travail stupéfiant sur le son en relation notamment avec les réactions quasi pathologiques du corps. Chez Beethoven, ces fulgurances qui ne trouvent un écho que dans la musique postérieure aux années 1950 sont exceptionnelles et il faut les accueillir comme des trésors miraculeux. Parmi eux – une dizaine peut-être – deux passages de la Sonate opus 110 que nous allons commenter brièvement.
Avant que Beethoven ne libère (mes. 9 [1’30]) le chant sublime de l’Arioso dolente, le 3e mouvement de la sonate commence par une sorte d’introduction réflexive où se succèdent huit tempos différents (Adagio ma non troppo [mes. 1 [0’00], più adagio (mes. 4 [27’’]), Andante (mes. 4 [45’’]), Adagio (mes. 5 [48’’]), Meno Adagio (mes. 6 [1’07]), Adagio (mes. 6 [1’12]), Adagio ma non troppo (mes. 7 [1’22]). C’est un nouvel exemple de la « mise en doute » d’une idée. Ici, le tempo choisi au départ par Beethoven se trouve plusieurs fois modifié – presque insensiblement d’ailleurs – et il est peu à peu ajusté. Mais ce n’est pas un simple réglage et chaque tempo est le théâtre d’un événement du discours où la pensée se cherche tout en exprimant d’elle-même quelque chose de profond. Parmi les outils utilisés par Beethoven, signalons le récitatif (il note au début de la mes. 4 « recitativo ») qui constitue le più adagio. Nous avons déjà relevé des récitatifs, dès l’Opus 31 n° 2 et nous ne commenterons pas celui-ci où Beethoven recourt à nouveau au style parlando pour être au plus près de l’intimité d’expression du discours non verbalisable de son âme avec sa visée de parler d’âme à âme ou « de cœur à cœur », comme il l’écrit un peu avant – au moment où il compose la sonate –, sur le manuscrit du Kyrie de la Missa Solemnis.
Cependant, ce qui nous semble le plus étonnant et le plus visionnaire, c’est le bref Adagio (mes. 5 [48’’]) qui tire toute sa substance d’une note unique répétée quatorze fois, au-dessus de deux accords en pédale. Ici la répétition de note n’est pas stricte comme les batteries de l’Opus 7, de la « Waldstein », de l’« Appassionata » : les figures rythmiques se raccourcissent (croche pointée, croche, double croche pointée, double croche) donnant donc un sentiment de légère accélération par palier, mais perturbée à la fin par un ritardando, découpe qui se rapproche plus des mouvements irrationnels de l’âme et du corps que du mouvement d’une logique intellectuelle structurante. En outre, l’écriture de Beethoven apporte un nouveau degré de complexité dans cet univers apparemment simple de la note unique : au lieu de noter par exemple des valeurs de croche (2e et 3e notes), Beethoven écrit chaque fois deux doubles croches liées ; la durée est la même mais le phrasé très différent, chaque note comporte une attaque et un rebond joué dans la résonance de la corde et qui n’a pas la même sonorité que l’attaque. Ce passage hallucinant d’une extrême difficulté d’exécution – même les plus grands trébuchent – traduit à la fois une sorte de halètement du corps et martèlement interrogatif de la manière sonore pour l’amener en quelque sorte à « parler ». Et c’est cette longue procédure multiforme, avec notamment cet épisode au plus près de la matière sonore et des impulsions ou des pulsions du corps, qui rend possible le chant sublime de l’Arioso dolente. Quand il reviendra pour la 2e fois après l’interpolation de la première fugue (mes. 27 [3’23]), la ligne mélodique sera trouée de silences qui la déchirent, une autre manière d’exprimer le halètement du corps (mes. 114 [5’21] sqq.). Mais voici qu’après ce chant angoissé et peut-être même désespéré, l’énergie vitale va ressurgir comme geste de volonté à travers une nouvelle séquence de notes répétées, des accords cette fois, accords qui n’ont aucune autre fonction que celle-là : « recharger les batteries » de l’être et réaffirmer son énergie.
Le passage commence au terme du diminuendo qui sous-tend la fin de l’Arioso dolente, fin que marquent quatre accords résolutifs (mes. 132 [7’09]) séparés de silences et énoncés dans une nuance à la limite de l’audible (voisinage du ppp). Le quatrième de ces accords va être répété dix fois, en se densifiant (3 [7’15] puis 6 [7’18] puis 8 [7’26] sons) et en s’intensifiant dans un puissant crescendo dont Beethoven n’a pas nommé le terme mais qu’il faut sûrement, à l’instar de Pollini, interpréter comme un ff ou un fff. Ce qui se passe ici est relatif à la masse et à l’intensité, en rien à l’harmonie. La résolution et la mutation harmoniques ont été accomplies dès le début du processus qui n’est qu’ivresse de prise de possession de soi-même, de son énergie, de sa force. Dépenser de l’énergie au-delà de ses forces pour les retrouver, il y a déjà ici l’idée de ce sentiment de « forces nouvelles » qui sera le principe directeur des parties II et IV du Chant de reconnaissance à la divinité du Quatuor opus 132.
6 – Sonate Opus 111, mutation de l’ut mineur, silence d’espace
La Sonate Opus 111, impressionnait tellement Florent Schmitt qu’ayant achevé son propre Opus 110, il passa directement à l’Opus 112, car selon lui il ne pouvait pas y avoir deux Opus 111.
De ce chef-d’œuvre si riche d’enseignement, nous tirerons ici deux leçons.
1ère leçon : mutation de l’ut mineur
Cette 32e Sonate est la dernière d’une longue série de partitions en ut mineur de Beethoven qui, pour les premières, écrites jusqu’en 1802-1803, forment une constellation d’œuvres qui participent à la formation du « style héroïque ». Ce style qui reflète sans doute quelque chose de l’épreuve de la surdité et des moyens que Beethoven met en œuvre pour l’affronter, culmine dans le 2e mouvement, Marche Funèbre, de la 3e Symphonie où toutes les énergies sont mobilisées par l’appel des trompettes guerrières de la partie centrale.
Après avoir été utilisée de manière quasi obsessionnelle avant 1802 (12 œuvres en ut mineur – dont les sonates Opus 10 n° 1 et Opus 13 « pathétique » – sur un total de 19 en mode mineur), la tonalité d’ut mineur ne domine plus aussi nettement (4/19) après cette date et c’est dans l’Opus 111 (1822) que Beethoven l’utilise pour la dernière fois comme tonalité principale d’une œuvre ; ce faisant, il fait subir une véritable transmutation esthétique à cette tonalité qui jusqu’ici a été le symbole le plus éclatant du combat héroïque de Beethoven contre l’adversité.
Survolant l’itinéraire de Beethoven à travers la tonalité d’ut mineur, nous écrivions en 1980,
« Lieu de l’angoisse et du mystère – peut-être celui du secret de la surdité cachée chez le jeune Beethoven – l’ut mineur devient le lieu par excellence du combat chez le Beethoven de la maturité, un combat restant sans issue favorable jusqu’à l’Opus 111 où le conflit se dissout dans la coda du 1er mouvement en ut mineur et introduit, en modulant insensiblement imperceptiblement vers ut majeur, la tonalité et le caractère apaisé du mouvement suivant, l’Arietta conclusive. […]
La victoire de l’ut majeur du finale de la 5e Symphonie est non seulement imposée par la volonté, mais elle éclate, triomphante de l’extérieur […]. La victoire de l’Opus 111, frémissante, intérieure, passe presque inaperçue ; elle est simplement suggérée. Elle apparaît comme une transsubstantiation ; le discours change profondément de nature : la nuance passe du fortissimo au piano, en une suite d’accords qui s’affaiblissent, la tonalité module tandis que la texture se transforme en un brouillard de doubles croches chuchotées dans le registre grave (mes. 146-158 [8’08-8’40, version Maurizio Pollini, 1977]).
Au-delà de sa signification humaine et morale – sorte de conversion intérieure, assomption sans résignation de ce qui est –, ce geste nous intéresse ici du point de vue de la pensée : la musique suggère une idée, la montre à l’œuvre plutôt que d’en faire le prétexte d’une glose verbale. Ce que Beethoven nous révèle ici de son intimité, de sa vie intérieure s’articule sur un universel qui, délesté de toute expression dogmatique, se manifeste pour chacun avec un sens propre en prise sur sa propre subjectivité.
2e leçon : la nécessité des extrêmes
Un des passages les plus forts émotionnellement et les plus originaux de cette œuvre qui en comporte tant, se trouve au début de la 5e variation lorsque les deux mains du piano jouent à cinq octaves d’écart (mes. 117 [12’24]). Le sens profond de ce geste puissant n’apparaît pleinement que dans sa relation avec ce qui s’est produit au cours de la variation 4.
Les 3 premières variations opèrent une sorte d’accélération rythmique de l’énoncé initial dont la figure centrée sur la croche pointée (thème), se focalise successivement sur la croche (variation 1, mes. 17 [2’43]), sur la double croche (variation 2, mes. 33 [4’41]), puis sur la triple croche (variation 3, mes. 49 [6’26]), la structure rythmique pointée donnant alors au discours une allure « pré-jazzistique », comme on l’a souvent souligné. Mais ce qui survient alors avec la variation 4 (mes. 65 [8’28] est encore plus intéressant et plus moderne.
Après cette progression toujours plus véloce et plus dynamique, le flux musical se trouve soudain comme figé, immobilisé. Deux singularités remarquables nourrissent cet abrupt contraste :
1) alors que le flux musical parcourait forte de bas en haut, de haut en bas tout l’espace du clavier (5 octaves), il stagne pianissimo dans le grave : trémolos en pédale à la main gauche, balancement syncopé sur deux notes à la main droite.
2) alors que les métamorphoses du thème s’articulaient toutes sur la figure pointée de la cellule génératrice du thème (croche, double croche, noire pointée), celle-ci en lisse toute aspérité et en défait la continuité.
Puis (mes. 72 [9’04]), la mélodie s’élance légèrement (leggiermente) dans l’aigu où elle séjourne longuement (mes. 73-80 [9’08-9’39], égrenant des notes cristallines. Retour dans le grave comme au début de la variation (pédale de trémolo, balancement syncopé), mais la figure du thème, toujours aussi lisse rythmiquement, joue maintenant avec des harmonies
plus inattendues, étranges et souvent névralgiques avec leurs dissonances par frottement (mes. 81-88 [9’39-10’19]). Nouvelle échappée dans l’aigu et nouveau jeu avec des timbres cristallins. Après une péroraison où l’on retrouve des sonorités plus habituelles et un paysage expressif plus familier grâce à son empreinte thématique, vient la stupéfiante transition (mes. 106-116 [11’26-12’24]) vers la variation 5, épisode entièrement pensé selon la figure du trille, passant par la culmination d’un triple trille (mes. 112-113 [12’01-12’14]) qui se résout en une simple ligne trillée se hissant chromatiquement vers l’aigu, sous laquelle résonne soudain, près de cinq octaves plus bas, le terrible sforzando qui inaugure, en mouvement inverse de la main droite, une ligne descendante de la main gauche si bien que l’espace musical écartelé entre les graves profonds et l’extrême aigu en vient à montrer (mes. 119 [12’37] un vide béant de près de 6 octaves, sorte de « silence de l’espace » comme Beethoven a inventé une nouvelle poétique du silence dans la palette des intensités.
CONCLUSION
Les différentes figures dont nous avons étudié la mise en œuvre dans les six sonates précédemment commentées nous éclairent sur la pensée de Beethoven, non seulement comme musicien, mais comme homme.
L’usage abondant – et même quasi obsessionnel –, diversifié et hautement expressif que Beethoven fait dans ces œuvres des notes répétées laisse supposer que cette figure revêtait pour lui, consciemment ou non, une valeur importante. Musicalement, il y a à travers elles, nous l’avons plusieurs fois souligné, une manière de partir de la matière sonore dans ce qu’elle a de plus primitif, le compositeur se trouvant devant elles, comme Moïse frappant le rocher, nous l’avons dit, mais plus encore peutêtre, comme l’apprenti sorcier qui s’essaye aux sortilèges de son art. Mais tout cela s’effectue également de manière extrêmement contrôlée et chaque fois avec un objectif esthétique spécifique. Philosophiquement, c’est peutêtre une manière d’explorer le mécanisme créateur du tout de l’œuvre à partir de rien ; inconsciemment, cela peut être référé au « fort und da » de Freud , au jeu de la bobine que l’enfant jette au loin et ramène pour déjouer la douleur de la séparation avec la mère. On retrouve dans les deux attitudes, celle de l’enfant – Ernst, le petit-fils de Freud – et celle de Beethoven, une même compulsion de répétition, mais les enjeux (inconscients) sont différents. Chez l’enfant qui « joue » – répétition du même geste d’éloignement et de rapprochement –, il s’agit d’éviter de se laisser aller à une manifestation pulsionnelle de colère contre sa mère lorsqu’elle revient. Pour Beethoven, nous ne connaîtrons jamais les raisons inconscientes qui le poussent à placer la répétition au cœur de son écriture. Il s’agit rarement alors de répétitions à l’identique de formules ou de motifs élaborés, mais de répétitions portant presque sur ce qu’il y a de plus primitif dans la musique, la « note » brute. Ce à quoi il faut s’intéresser, une fois constatée l’origine pulsionnelle du phénomène, ce n’est pas l’inatteignable « pourquoi ? », c’est le « comment ? ». Nous constatons en effet que ce geste souvent compulsif prend dans la poétique beethovénienne les formes les plus différentes et participe des stratégies discursives les plus diverses ; nous l’avons noté en commentant les sonates Opus 7, 53, 57, 110. Sans trop s’aventurer dans une discussion des causes, on peut conjecturer que, par l’usage compulsif des notes répétées, Beethoven déjoue et dénoue des conflits internes latents, qu’il contrecarre l’angoisse
Autre figure importante rencontrée dans notre parcours des sonates, celle de l’opposition des contraires, de la rupture, des soudains changements de Stimmung, de climat, de paysage expressif, découlant de l’inversion subite et simultanée de nombreux paramètres musicaux (grave/aigu, massif/frêle, rapide/lent, forte/piano, rugueux/lisse, solide/fluide, linéaire/circulaire, etc.). Il se peut que ces ruptures trouvent leur origine dans la vie du jeune Beethoven ; Madame Breuning, mère d’Eléonore pour qui l’adolescent avait une forte inclination, remarquait combien était fréquent chez lui le brusque passage d’un état mental à un autre, en une sorte d’arrachement soudain à la réalité du moment qu’elle nommait raptus.
Le jeu de Beethoven avec les oppositions s’applique non seulement à maintes catégories, il s’exerce aussi selon les modalités les plus diverses tant quantitativement (implication d’un nombre plus ou moins grand de paramètres) que qualitativement (différents types d’oppositions synchronique ou diachronique, successives ou simultanées, etc.) et il prend toutes sortes d’aspects et de physionomies.
Ce qui est peut-être le plus connu et certainement le plus caractéristique, c’est le goût de Beethoven pour les oppositions radicales qui se traduisent par des contrastes abrupts et servent d’argument à un jeu dialectique dont l’issue privilégie une des forces en présence. Mais plus subtilement et plus profondément, le discours beethovénien exprime une inquiétude et presque une philosophie du doute. Cela apparaît clairement dans la Missa Solemnis et dans les derniers quatuors, notamment l’Opus 135. Le message beethovénien s’exprime davantage par l’incitation à l’action face à l’adversité plutôt que par la force d’affirmation d’une vérité. Ainsi dans la Missa Solemnis, le Credo est plus un « vouloir croire », comme le dit Romain Rolland, qu’une profession de foi. De même, en priant dans l’Agnus Dei pour la paix extérieure et intérieure, Beethoven ne manifeste pas d’illusion sur ce qui pourrait advenir et le dernier mouvement de la messe montre le doute, notamment quand on entend les timbales guerrières résonner encore, malgré la prière de paix. Mais c’est le « Muss es sein ? – Es muss sein ! » (le faut-il ? – il le faut !) qui se révèle le plus éclairant de la pensée de Beethoven, car la réponse joyeuse du Es Muss sein ne cesse d’être lestée et compromise par le poids de la question. Et pourtant le message de Beethoven reste optimiste, mais ce qu’il nous dit ce n’est pas « Voilà la vérité », mais plutôt « Voilà le chemin » et ce chemin, c’est l’action – notamment la création artistique qui en est la quintessence – envers et contre tout, action grâce à laquelle la vie est éclairée par l’espérance, au sens Héraclitien du terme, où, sans elle, « on ne saurait trouver l’inespéré ».
Cette conception philosophique de Beethoven qui apparaît très nettement dans les derniers quatuors et la Missa Solemnis – que nous espérons commenter plus longuement dans un prochain article – irrigue aussi les sonates mais de manière plus souterraine, car la puissance des contrastes et la radicalité des solutions souvent mises en œuvre en cachent quelquefois le caractère à la fois volontaire et incertain.
Tous les passages commentés qui, dans les sonates, s’articulent autour de figures de notes répétées (Opus 7, 53, 57, 110) montrent ce double mouvement d’élan créateur à partir d’un symbole du « rien »» et de mise en question de ce qui est ou de ce qui est en passe d’advenir (Opus 110 particulièrement). Les passages récitatifs de l’Opus 31 n° 2 (mais il y en a aussi dans d’autres sonates postérieures dont l’Opus 110) portent un sentiment d’inquiétude, de mise en question. Les deux récitatifs de la réexposition (mes. 144 [5’32], 155 [6’47]) sont interrompus par le retour du discours qui, après le 2e, mène à son terme nécessaire, quoique avec des surprises, le processus rhétorique à l’œuvre dans le mouvement. Cependant, l’incertitude, le questionnement, le doute induits par le parlando intime des récitatifs ne sont pas balayés parce que le discours reprend son cours normal et les questions qu’ils posent ne trouvent pas davantage de réponse, d’autant qu’elles semblent plutôt éludées. C’est pourquoi, le mouvement reste sous l’emprise d’une sorte de Muss es sein ? symbolique que relaie d’ailleurs la coda toujours empreinte de dramatisme, mais n’assumant aucune fonction « résolutive », tapie qu’elle est dans le grondement pianissimo de ses arpèges graves (mes. 219 [8’19]).
Quant aux oppositions de toutes sortes qui jalonnent les sonates, elles ne sont pas, elles non plus, toutes résolues par le travail de l’écriture. Si les mouvements résolvent toujours, comme le veut le style de cette époque, les conflits harmoniques, ils ne résolvent pas nécessairement d’autres types de conflits inscrits dans la trame musicale et qui sans doute sont sous-tendus par les « raptus » de l’homme Beethoven mais plus généralement par son inquiétude.
Ainsi, dans l’Opus 111, la béance, précédemment décrite, entre la ligne aiguë du piano à la main droite et la ligne grave à la main gauche n’est pas comblée par les gestes de conciliation du piano. Elle fait porter son poids d’angoisse sur toute la fin de la sonate.
Ce que Beethoven nous dit à travers sa poétique des oppositions est loin d’être univoque. Sa musique est le théâtre d’une mise en présence des opposés qui peut déclencher aussi bien de violentes et destructrices confrontations, que des synthèses harmonieuses ou d’indifférentes cohabitations des contraires. Dans sa recherche de la vérité, Beethoven qui aime dépasser les contradictions et peut certes se montrer péremptoire pour défendre un des volets d’une alternative, est également capable de rendre féconde la conjonction des contraires, comme s’il pensait que la contradiction est un signe de vérité. Cette tendance se renforce dans le style tardif, et notamment dans les dernières sonates. Comme le remarque Adorno, « les œuvres tardives des grands artistes […] ne sont pas lisses en général, mais ridées voire déchirées […] Il leur manque toute cette harmonie que l’esthétique classiciste est accoutumée à exiger de l’œuvre d’art ». Cela signifie précisément que, loin de réconcilier les forces contraires qui animent le compositeur, le temps exacerbe les contradictions sans solution. Mais une des forces exceptionnelles de l’esthétique du dernier Beethoven, c’est que ces déchirures et ces hiatus assumés n’empêchent pas – bien au contraire – le compositeur d’atteindre dans sa musique une sérénité et un apaisement sans précédent et sans doute sans équivalent.
Assumées comme telles dans leurs tensions et leurs forces disruptives, les oppositions sont génératrices d’une énergie surpuissante qui se manifeste aussi bien dans l’expression tragique que dans la fièvre dionysiaque ou les manifestations cataclysmiques du discours .
Acceptées à l’inverse sans lutte comme deux visages contraires mais nécessaires d’une même réalité, les oppositions induisent une intériorisation de l’énergie à laquelle Beethoven peut donner une valeur hiératique, extatique ou ataraxique, un caractère « numineux ».